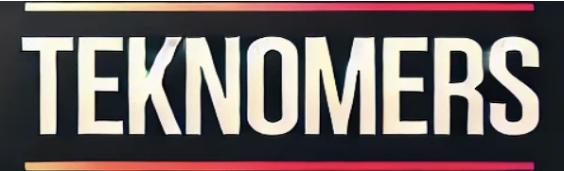Les images sont des histoires et si vous savez raconter des histoires, elles deviennent des images, des voyages, des inspirations.
Dans un extraordinaire jeu de rôles, le mot et la photographie se passent le relais de la suggestion et, même s’ils ne l’avouent pas toujours, ils s’aiment. Aujourd’hui, plus que jamais, ils forment un couple de fait, grâce aux podcasts et à nos nouvelles habitudes marquées par les appareils.
Une photo, une histoire est une série de podcasts – pour l’instant six épisodes mais une suite est attendue – qui, à partir du 19 janvier, propose une photo, une histoire en fait, tous les quinze jours. Produit par Contrasto et storielibere.fm, conçu et créé par Alessandra Mauro, directrice artistique de la Fondation Forma pour la photographie et directrice éditoriale de Contrasto editore.
Pour ceux qui ne les ont pas encore écoutés, vous pouvez repartir du troisième épisode, qui vient de sortir, qui fait face au portrait de Parcs Gordon à Muhammad Ali, l’occasion d’écouter non pas une, mais deux vies extraordinaires, entre racisme et rédemption. Dans le premier épisode à la place, à partir du portrait d’une magnifique Audrey Hepburn dans l’un des costumes les plus célèbres de l’histoire du cinéma et de l’icône de la mode dans le film ma belle dame, on croise la vie de Sir Cecil Beaton, un viveur éclectique et créatif qui de commandes pour Vogue aux portraits de la royauté anglaise, il a su vivre et représenter magnifiquement son époque. Parmi les épisodes déjà en ligne, le second est consacré à Milice De Robert Capa et les mystères de la photographie la plus controversée de l’histoire, encore aujourd’hui 80 ans après sa création.
Les trois autres épisodes, diffusés tous les quinze jours sur les plateformes de podcasts les plus connues, seront consacrés à la fille afghane de Steve McCurry, la métaphysique de Marina di Ravenna de Luigi Ghirri et le baiser de l’Hôtel de Ville de Robert Doisneau, la reine de la quintessence Icônes.
Nous avons demandé à Alessandra Mauro la raison de cette série et quelque chose de plus personnel sur sa relation avec la photographie.
Alessandra Mauro dans un portrait de Marco Rapaccini
D’où vient votre intérêt pour la photographie ?
Il y a eu des signes qui m’ont montré ce chemin : pendant que j’étudiais la littérature, j’avais une passion – je l’ai toujours – pour les cartes géographiques et les mémoires de voyage et la photographie est un voyage. Après avoir obtenu mon diplôme et séjourné à Bangkok, Paris et Washington, de retour à Rome, j’ai commencé à travailler pour un magazine brillant et élégant, Sfera. Là, travaillant à la rédaction, j’ai commencé à apprendre les images et leur importance.
Contrasto, à l’époque agence photographique, était le fournisseur privilégié vers lequel je me tournais pour enrichir les pages de contenus visuels. Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour tomber amoureux et comprendre qu’ici je pouvais faire des choses qu’une agence ne faisait pas à l’époque : des livres et des expositions. Ainsi commença l’aventure.
C’est au milieu des années 90 que l’ère analogique passe le relais au numérique et que le millénaire s’achève avec l’explosion du web. La maison d’édition Contrasto est née avec vous. Au cours de ces années, vous avez fait beaucoup de choses : vous enseignez, organisez des expositions, éditez des livres. Qu’est-ce qui vous passionne vraiment dans la photographie ?
Ce qui me fascine le plus, c’est l’histoire. Je pars toujours de l’image : j’aime la dimension narrative de ce langage, son potentiel à raconter des histoires.
Les neuroscientifiques nous ont récemment informés que l’ouïe et la vision sont les deux sens que nous utilisons le plus. Cela explique bien le succès des podcasts. Et dans cette série : Une photo, une histoire, il y a la synthèse de nos sens préférés, l’ouïe et la vue, comment est-elle née ?
Une photo, une histoire est une coproduction Contrasto et storielibere.fm : ils m’ont demandé d’essayer de faire un podcast. J’aime raconter des histoires, j’aime la radio avec laquelle j’ai l’occasion de collaborer, j’aime parler et écouter. J’ai donc essayé d’écrire ces six premiers épisodes : chacun part d’une image souvent connue et iconique mais pas toujours. J’essaie de les décliner en élargissant le récit : une icône comme l’Afghan girl de Steve McCurry est le point de départ pour parler de photographie et de voyage, une combinaison aussi ancienne que la photographie elle-même. J’ai essayé de créer un équilibre entre des images familières et des images moins connues comme la première qui ouvre la série : Audrey Hepburn photographiée par Cecil Beaton dans la robe My Fair Lady. Normalement, ce n’est pas identifié comme de la photographie de mode mais dans ce cas, je l’ai abordé de cette façon, racontant l’auteur et sa vie folle.
La richesse des détails et des anecdotes nous fait penser que vous avez beaucoup étudié en faisant de vraies recherches.
Oui, j’ai travaillé très dur dessus. Je veux parler à ceux qui ne connaissent pas ou peu la photographieou. Pour moi, l’intention de vulgarisation de cette initiative était immédiatement claire. J’ai puisé dans mon expérience d’enseignement : expliquer à quelqu’un qui ne connaît absolument rien à un sujet donné et découvre en un instant le pouvoir de la photographie pour diffuser les connaissances. Je suis allé chercher dans les livres, trouver des anecdotes : c’était un travail d’analyse et surtout de synthèse. Du particulier à l’universel, de courtes leçons qui touchent transversalement aux coutumes, à la société, à la culture en enchaînant les détails, dévoilant de petites histoires pour respirer une époque, un lieu et en apprendre un peu plus sur l’histoire contemporaine.
Dans ces fresques d’époque, vous avez soigneusement évité de toucher à la vie privée des artistes. Pourtant, il y aurait eu quelque chose à dire sur Cecil Beaton, sans parler de Robert Capa.
Certes, j’ai essayé d’éviter les commérages et aussi les spéculations. Que sait-on si Robert Capa a vraiment souffert pour Gerda Taro (la photographe, sa compagne et compagne, morte accidentellement en Espagne à 26 ans pendant la guerre civile) ?
Vous avez raison, mais le public auquel vous vous adressez ne sait peut-être pas que Bob Capa, le photographe le plus fascinant de l’histoire, a toujours eu une relation assez sérieuse et longue avec Ingrid Bergman, la légende.
Tu as raison, j’aurais pu dire ça.
Robert Capa est l’auteur de l’une des images les plus controversées de l’histoire de la photographie : le milicien qui tombe et est abattu. Son authenticité a été mise en doute pendant de nombreuses années, notamment parce que le film n’a jamais été retrouvé. Était-ce le résultat de l’habileté d’un grand reporter ou était-ce astucieusement construit? Dans l’épisode dédié, il semble que vous preniez la version de son authenticité pour de bon.
Il est si fort que je pense qu’il mérite pleinement d’être dans cette série. Chaque photographie est un document et en tant que tel peut être falsifiée mais aujourd’hui nous connaissons l’origine de cette image grâce à la découverte récente de l’audio d’une interview radio Robert Capa 1947: le photographe n’a pas pointé le sujet, il a mis l’appareil photo au-dessus de sa tête et a pris la photo. C’est une affirmation digne de Capa : l’une des plus grandes icônes du XXe siècle a été photographiée ainsi, par hasard. Pourtant, malgré les mystères et les révélations, cette image du milicien reste une icône très forte qui contient l’écho de laecce homo d’autant de représentation ou celle de Déposition de Jésus et bien d’autres images d’abandon, de fugacité humaine. Beaucoup de photographies de guerre ont été inspirées, et je pense qu’elles s’inspirent encore aujourd’hui, de cette image.
Ne pensez-vous pas qu’aujourd’hui il serait impossible de faire le Milice? La production photographique est inexorable et rampante, les guerres et, plus généralement, les événements mondiaux, sont hyper-représentés. Pensez au cas de George Floyd, l’Afro-américain brutalement tué par la police de Minneapolis en 2020 : le témoignage est confié aux images d’une vidéo anonyme qui cloue les policiers sur la responsabilité d’un meurtre qui a duré huit minutes. Aujourd’hui, nous sommes tous potentiellement témoins et producteurs d’icônes. Qu’en est-il des images protégées par le droit d’auteur ? Ils ne sont plus nécessaires à l’information qui pêche partout sur le net tout en se réclamant du collectionneur et plus généralement du marché de l’art. Quelles icônes aurons-nous à l’avenir ?
Je crois qu’un certain type de photojournalisme, le classique pour être clair, atteindra toujours le marché de l’art. Imaginez si aujourd’hui nous retrouvions le négatif de milice, ce serait un super scoop et aussi un achat pour le marché puisque c’est un document, c’est comme si on retrouvait des lettres inédites de Winston Churchill : ce sont des documents rares et c’est pour cela qu’ils ont de la valeur. La production photographique contemporaine est très orientée vers la création de dieux tableaux photographiques, faisant un clin d’œil au marché de l’art et poussant généralement la photographie du côté interprétatif. Les reporters d’aujourd’hui font face à la guerre d’une manière complètement différente de celle que Capa aurait pu affronter il y a 80 ans : ils vont en Ukraine en pensant déjà à une exposition.
Mais c’est une tendance largement répandue si même Sebastião Salgado, célèbre et primé interprète des grandes questions d’humanité, réalise ses images les plus célèbres, dont celles de la terrible famine du Sahel de 1984, précieux tirages au platine en vente chez Sotheby’s. Elle nous fait penser que le photojournalisme, orphelin de la grande presse mondiale, son premier client, se bat pour obtenir l’attribution d’une valeur artistique et commerciale à chaque tragédie de la planète.
Il n’est pas facile de comprendre les mécanismes actuels du marché de l’art.
Revenons à la série de podcasts, vous avez mélangé des photographies très différentes. Expliquez le critère.
Je dirais que dans cette première série j’ai réuni trois photos iconiques : le milicien, la fille afghane de Steve McCurry et le baiser de Robert Doisneau, en les alternant avec des images moins connues et moins évidentes si vous voulez : l’image de My Fair Lady de Cecil Beaton, s’il est vrai qu’il est une icône de la mode, n’est en revanche pas si connu et surtout peu savent que lui, Beaton, a également été le costumier de ce film et d’autres, remportant pas moins de deux Oscars. L’autre image moins célèbre est celle de Gordon Parks de Muhammad Ailes dont l’épisode vient de sortir sur les plateformes de podcast et enfin Luigi Ghirri, maître de la photographie italienne, l’auteur qui a changé à jamais l’histoire du territoire et le concept même de paysage. A partir de lui, j’ai pu vraiment élargir la discussion en parlant du groupe de peintres photographes du Caffè Greco ou de la première photographie de Rome. Nous sommes au Bel Paese, c’est notre condamnation et notre beauté de vivre dans un lieu aussi observé et représenté. Il est important de comprendre comment l’observer, ce fut la grande leçon de Luigi Ghirri.
Au final, ces six premiers épisodes sont des récits de photos dédiées à un public très hétéroclite qui ne peut plus voir la photographie uniquement comme les images des journaux et des pixels ou celle des musées et galeries qui dans notre pays peinent à trouver un public si le les auteurs ne sont pas encore connus. Malgré cela, la photographie est de plus en plus un langage à connaître et à aimer.
De nombreuses photos sont donc les bienvenues pour de nombreux récits à la découverte du monde d’hier et d’aujourd’hui.
iO Femme © REPRODUCTION RÉSERVÉE