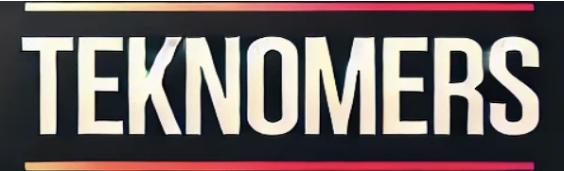De nombreux défenseurs de l’environnement commençaient déjà à désespérer, mais samedi soir heure locale, l’heure était enfin venue à New York. Après plus de 15 ans de pourparlers, cinq sommets, trois précédentes sessions de clôture ratées et plus de 38 heures de négociations continues, les Nations Unies sont parvenues à un accord pour un traité sur la protection et le développement durable des océans. “Le navire a atteint le continent”, a déclaré avec soulagement la présidente singapourienne Rena Lee.
Des délégations d’environ 160 pays se sont mises d’accord à New York sur une convention-cadre contraignante pour la protection de la biodiversité dans le haute mer, les eaux internationales « au-delà de la juridiction nationale » couvrant les deux tiers des océans. Les océans sont extrêmement importants pour toute vie sur la planète – ils produisent la moitié de l’oxygène, régulent le climat et nourrissent des milliards de personnes – mais moins de 1,2 % sont protégés. Cela les rend vulnérables à la pollution et à la surpêche. Avec le traité convenu, des zones marines protégées (réserves marines) peuvent être établies dans les océans.
Construction prédatrice humaine
Cela fait de l’accord une condition cruciale pour l’objectif convenu lors du Sommet des Nations Unies sur la biodiversité à Montréal en décembre de donner à 30 % des mers et des océans (et des terres) un statut protégé (« 30 x 30 ») d’ici 2030, afin qu’ils abritent des conséquences de la surexploitation humaine – et peut-être même capable de se rétablir. Près de 10% des espèces océaniques sont menacées d’extinction, dont 15% des coraux, 67% des poissons osseux et 90% des requins et des raies, selon l’UICN. Et puis d’innombrables espèces dans les océans ne sont même pas encore connues.
L’accord a été difficile à obtenir en raison de tous les intérêts économiques. La principale pierre d’achoppement a été l’écart entre les pays riches et les pays en développement sur la manière dont la protection des océans se compare à l’exploitation durable, sur les activités économiques autorisées ou non dans les zones protégées et sur la manière de rendre cette exploitation aussi équitable que possible. Outre le transfert de technologie (marine), cela concernait principalement la distribution du produit des «ressources génétiques» – le matériel biologique et génétique des éponges, des coraux, des algues, du krill et des algues qui sont importants pour d’innombrables applications biotechnologiques et pharmaceutiques.
Gestion durable
L’accord qui vient d’être conclu contient les éléments les plus importants nécessaires à la protection et à la gestion durable des océans : le cadre juridique international pour la désignation des aires marines protégées et l’accord sur ce qui y est autorisé et interdit ; des règles sur la manière dont les activités économiques planifiées sont testées et contrôlées ; et des accords sur une répartition équitable des bénéfices.
La principale chose qui semble avoir échoué est le financement généreux du processus. Les pays riches et développés se sont montrés réticents à rencontrer les pays en développement avec les milliards souhaités. Bien que l’UE ait promis jeudi 820 millions d’euros pour la protection des océans afin de sortir de l’impasse des négociations. En revanche, l’accord n’a pas ricoché sur l’argent.
Les initiés ont immédiatement souligné hier que les travaux ne commenceront qu’après l’accord de New York. Les délégations doivent revenir pour adopter formellement le traité et convenir de son élaboration ultérieure. Le processus de ratification commence alors : les pays doivent enchâsser le traité dans leur propre législation. L’expérience montre que ces ratifications échouent parfois (les États-Unis n’ont jamais ratifié la Convention des Nations Unies sur la biodiversité). Ce n’est que lorsqu’une majorité qualifiée de 40 à 60 pays auront signé le traité qu’il entrera officiellement en vigueur.
réserves marines
Il est crucial que ce processus soit achevé le plus rapidement possible afin d’atteindre l’objectif de 30 %. Selon Greenpeace, au moins 11 millions de kilomètres carrés d’océan doivent être protégés chaque année jusqu’en 2030. Ces réserves marines doivent être situées aux bons endroits et connectées, car de nombreuses espèces, comme les baleines, migrent. “L’horloge tourne pour 30 x 30. Il nous restera bientôt une demi-décennie et nous ne pouvons pas nous asseoir et nous détendre”, a déclaré Laura Meller de Greenpeace.
La décision de ce week-end peut néanmoins être qualifiée d’historique. “Ce traité change la donne dont les océans ont désespérément besoin”, a déclaré Fabienne McLellan de l’ONG OceanCare. Dans un monde géopolitiquement plus divisé que jamais, deux mois et demi après l’accord de Montréal, les États membres de l’ONU ont une fois de plus réussi à transcender leurs divisions et à montrer que la nature est quelque chose qui finalement les relie tous. Un signe d’espoir.