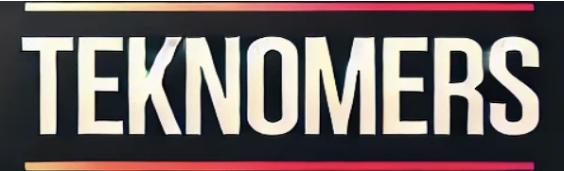“J’ai peur que cela ne s’arrête pas là et que les gens rendent également l’accès aux contraceptifs difficile.” L’annulation de « Roe v. Wade » aux États-Unis ne rend pas très heureuse la professeure Marleen Temmerman. “Ce serait peut-être une bonne idée d’inscrire le droit à l’avortement en Belgique dans la Constitution.”
La professeure Marleen Temmerman (69 ans), actuellement directrice du département de gynécologie et d’obstétrique de l’université Aga Khan de Nairobi, au Kenya, est sur les barricades depuis des années pour les droits des femmes et les droits reproductifs en particulier. Elle regarde avec tristesse la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler le droit constitutionnel à l’avortement.
“La confusion et l’incertitude l’emportent”, dit-elle. « Certains États garantiront l’accès, d’autres aboliront complètement le droit à l’avortement. En d’autres termes, l’uniformité disparaît. Vous pourriez dire : « Bon, qu’il en soit ainsi, peu importe si c’est différent au Texas, à New York ou à Philadelphie. C’est le cas pour encore plus de choses. Mais pour l’avortement, cela rend les choses beaucoup plus complexes. Le problème majeur se posera principalement dans les États où l’avortement est criminalisé pour les femmes et les prestataires de soins. Je me souviens de ça avant 1990, quand l’avortement était encore illégal en Belgique.
Comment estimez-vous l’impact ?
« Les femmes des classes sociales supérieures trouvent toujours le moyen d’aider. Ce ne sera pas différent aux États-Unis maintenant : elles peuvent facilement se permettre de voyager dans un autre État pour un avortement sécurisé. Elles seront aidées à interrompre leur grossesse. Mais les femmes qui n’ont pas ces relations et l’argent sont en difficulté. Où doivent-ils aller ? Soit ils vont mener la grossesse à terme, mais ce n’est parfois pas une option. Ou ils doivent se réfugier dans des solutions non médicales, illégales et criminelles. En utilisant toutes sortes de moyens dangereux, comme essayer d’ouvrir l’utérus avec une aiguille ou prendre des produits dangereux. Avec toutes les conséquences que cela entraîne pour leur santé.
La mortalité maternelle aux États-Unis est déjà beaucoup plus élevée que dans les autres pays industrialisés : 19 décès pour 100 000 naissances. En Belgique il y en a 5. Alors ce chiffre va aussi augmenter ?
« En effet, et là encore ce sont les femmes les plus vulnérables qui sont le plus souvent les victimes. Elles ont moins accès aux soins de santé et à la contraception. On l’a vu en Belgique avant la légalisation de l’avortement. Il existe maintenant plus de méthodes, y compris des médicaments qui peuvent être commandés en ligne. Mais si quelque chose ne va pas, les gens doivent toujours pouvoir se rendre rapidement dans un hôpital ou un centre d’avortement. Et avec la criminalisation, les travailleurs humanitaires seront souvent réticents à aider. Ils courent le risque de finir en prison.
Le nombre d’avortements va baisser de manière significative, affirment les partisans d’une nouvelle approche stricte dans certains États.
“Des recherches, notamment par l’Institut américain Guttmacher, montrent que ce n’est pas vrai du tout. Au contraire, le nombre d’avortements ne fera qu’augmenter. Les meilleurs élèves de la classe – où se produisent le moins d’avortements – sont les pays où l’éducation sexuelle est équilibrée, où les contraceptifs sont facilement disponibles et où l’accès à l’avortement est facile.
« En premier lieu, la prévention est donc importante. Et dans les pays où l’avortement est très strictement réglementé – comme c’est aussi le cas aujourd’hui dans divers États américains –, il apparaît que les gens ont souvent une vision négative des droits des femmes et des contraceptifs. Je crains que cela ne s’arrête pas là et que l’accès aux contraceptifs soit également rendu difficile.
Comment cela peut-il être encadré historiquement ? N’étions-nous pas simplement sur la voie d’une plus grande libéralisation internationale ?
« Le droit à la contraception est l’un des jalons des droits reproductifs. En 1994, dans le cadre de l’ONU, une grande conférence s’est tenue au Caire, qui a établi les droits reproductifs des femmes pour la première fois dans l’histoire. Ce texte a été signé par presque tous les pays. Il s’agit du droit de chaque fille ou femme de décider qui, quand et à quelle fréquence elle tombe enceinte. Un an plus tard, un plan d’action concret a été convenu pour mettre cela en œuvre.
« Cela peut nous sembler étrange, mais pour de nombreux pays, c’était un grand pas en avant. En 2019, une conférence à Nairobi est revenue sur ces 25 années. Il a été examiné s’il y avait un meilleur accès à l’avortement. Si les femmes sont désormais autorisées à décider par elles-mêmes, y a-t-il moins de mariages forcés, y a-t-il plus d’accès aux contraceptifs ? La conclusion était que des progrès avaient été accomplis dans un certain nombre de pays, mais qu’il restait encore beaucoup de travail à faire.
«De plus, ces dernières années, nous avons constaté un recul très calculé des mouvements conservateurs, machistes et religieux. Toujours en Europe, regardez la Pologne et la Hongrie. Non seulement les droits reproductifs, mais aussi l’égalité des droits de la communauté LGBTQ+ sont sous pression.
Comment ces forces parviennent-elles à exercer une telle influence ?
«Ils gèrent bien tactiquement. J’ai l’impression qu’il y a aussi beaucoup d’argent derrière. Je l’ai remarqué récemment à New York lors de l’organisation annuelle de Status of Women. Trois jours avant, un événement parallèle organisée par des communautés religieuses, qui rassemblait beaucoup de jeunes et était bien organisée. Ils investissent depuis des années dans divers pays.
« Et il y a l’influence des religions. Je remarque cela ici au Kenya. La constitution est assez progressiste, mais il y a une influence croissante des églises évangéliques. Le Vatican a également salué la décision américaine. Nous connaissions déjà leur position, ils auraient aussi pu choisir de se taire et de ne pas s’immiscer politiquement.
Quels sont les effets en dehors des États-Unis ? Y aura-t-il un effet domino maintenant ?
“Bien sûr, il n’est pas vrai que les droits seront soudainement supprimés en masse dans d’autres pays, mais les États-Unis ont en effet une influence importante. Ici aussi au Kenya, tout le monde en parlait. Il y a eu un débat pour et contre pendant quelques jours, puis c’est parti retour à la normale†
Quand il pleut aux États-Unis, il goutte en Europe. Faut-il s’attendre à un scénario similaire en Belgique ?
« Non, je ne pense pas que la législation sur l’avortement en Belgique sera inversée. Mais peut-être serait-il judicieux de l’inscrire dans la Constitution, comme plusieurs voix le suggèrent désormais. Alors il y a une certitude absolue qu’on ne peut pas y toucher. En Belgique, ils continueront à discuter des modalités, mais le principe est fixé.
Comment voyez-vous l’avenir ? Vous n’avez pas l’air très positif.
« J’essaie toujours de rester optimiste. Il est très important que nous nous organisions mieux. Il faut essayer de convaincre les gens avec des arguments et des faits, chacun a son opinion. Par exemple, en indiquant que la mortalité maternelle et le nombre d’avortements ne font qu’augmenter dans les pays où la législation est très stricte.
« Et soyons clairs : personne n’est pour l’avortement. Il n’y a personne qui dit : ‘Maintenant je vais tomber enceinte pour pouvoir avorter après’. Mais nous sommes en faveur de la légalisation et de l’accès sécurisé à l’avortement, ce qui est une distinction importante. C’est et reste une solution d’urgence.