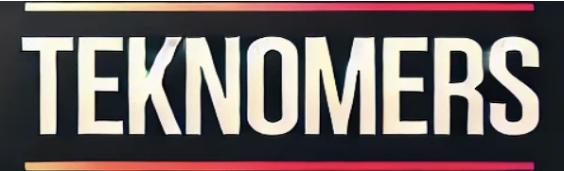La raison pour laquelle l’autocrate russe Vladimir Poutine déteste tant les États démocratiques est qu’il connaît bien leurs faiblesses. Il essaie d’exploiter pleinement cette situation alors que la guerre en Ukraine entre dans un deuxième hiver.
La caractéristique d’une démocratie est qu’elle permet la contradiction, qui peut conduire à des hésitations ou à des renversements. Le président ukrainien Zelensky en fait désormais également l’expérience. Son voyage de mendicité à Washington n’a donné lieu à aucun chèque. Dans le même temps, l’Union européenne doit également lutter avec la Hongrie pour obtenir un nouveau prêt d’un milliard de dollars pour l’Ukraine.
Poutine n’est pas gêné par de tels désaccords. Il a récemment annoncé discrètement qu’il souhaitait lui succéder à la présidence. En plus de cela, il y avait une petite menace contre les pays baltes, simplement parce que c’est possible. Cette initiative semble également avoir changé de camp sur le champ de bataille en Ukraine.
Nous devrons simplement attendre et voir à quel point cette évolution sera décisive. Poutine tient à donner l’impression qu’il contrôle la guerre. La réalité est plus grise. Les estimations montrent que les Russes pourraient avoir déjà perdu plus de 300 000 soldats, ainsi qu’une partie importante de leur équipement d’origine. Poutine a réussi à éviter la crise intérieure pour l’instant en concentrant l’économie sur la guerre et en partant du principe qu’il y aura toujours un client quelque part pour son approvisionnement en combustibles fossiles. Cela n’exclut pas que ce château de cartes bâti sur l’inflation s’effondre tôt ou tard.
La morosité hivernale entourant la situation en Ukraine a effectivement un effet. La chroniqueuse Alicja Gescinska, à contrecœur et par « découragement de guerre », a plaidé en faveur Le matin déjà pour une « solution diplomatique qui permettrait à Poutine d’obtenir des gains territoriaux ». L’alternative, affirme-t-elle, consiste à prolonger inutilement les souffrances de la guerre. Elle n’est en aucun cas seule sur le point de prendre ce virage.
Il y a une double erreur dans ce raisonnement. Poutine ne réclame pas un rapprochement occidental. Le prix qu’il demande pour quelque chose comme la paix sera extrêmement élevé. Deuxièmement, rien ne garantit qu’il finira par faire la paix avec le territoire actuellement occupé. La faim impériale n’est pas satisfaite.
C’est pourquoi l’Ukraine et ses soutiens n’ont d’autre choix que de persévérer, malgré toute la douleur, et d’espérer que la façade russe se fissurera d’abord. À court terme, on espère que le Congrès américain parviendra encore à trouver un accord sur l’argent pour l’Ukraine et que l’UE tiendra également ses promesses financières, avec ou sans le soutien d’Orbán. Mais le danger d’un renversement de politique n’a pas disparu. Il existe une réelle chance que Trump revienne à la Maison Blanche et que l’homme de main de Poutine, Geert Wilders, rejoigne le gouvernement néerlandais. À la Chambre des représentants, son groupe a déjà voté contre un soutien supplémentaire à l’Ukraine.
Cette aventure néerlandaise donne également matière à réflexion aux électeurs flamands. Le choix pour ou contre la droite (ou la gauche) radicale comme éventuel parti de gouvernement n’est certainement pas seulement une question de tactique et de bouclage. Cela ne fait pas de mal de réfléchir à l’avance à toutes les conséquences, y compris internationales.