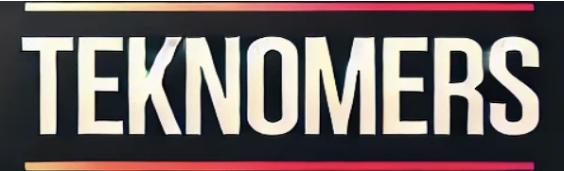Mark Elchardus est professeur émérite de sociologie à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et auteur de Réinitialiser et Liberté/sécurité. Sa contribution est publiée toutes les deux semaines.
Au XIXe siècle, la réflexion sur le vivre ensemble était dominée par la conviction que tout est une question de lutte. L’histoire n’a vu que la guerre, l’assujettissement et la domination. La fin justifie les moyens et le plus fort gagne. Cette pensée était régulièrement liée à d’autres croyances. Beaucoup pensaient que la victoire n’avait rien à voir avec la culture et les institutions, mais était inscrite dans les gènes : des races supérieures gagnées, des races inférieures perdues. Cela a été considéré comme une bonne chose. Des progrès ont été constatés dans l’assujettissement ou l’élimination des plus faibles.
Il est encourageant de voir avec quelle rapidité nous sommes passés de cet éloge de la brutalité à une façon de penser qui laisse place aux valeurs, aux normes et à la faiblesse. Cette révolution culturelle s’est produite en peu de temps, mais non sans difficultés. Le bolchevisme et le fascisme mettent en pratique la pensée brutale. Heureusement, de nombreuses sociétés ont choisi une voie dans laquelle l’usage du pouvoir est soumis à des normes (par exemple une constitution) et le peuple est élevé au rang de gardien de ces normes (la démocratie). Ce sont ces sociétés plus douces qui – ironie de l’histoire – ont vaincu les régimes de pensée brutale, militairement dans le cas du fascisme ; économique, social et culturel dans le cas du bolchevisme.
Cependant, ce que font les gens est vulnérable. Nous nous soumettons à une constitution et à des lois, mais en confions le contrôle aux juges. Tant que le peuple, à travers ses représentants, reste le gardien ultime des normes et des lois, cela fonctionne plus ou moins. Dès que le juge est autorisé à se placer au-dessus du peuple et de ses élus, la démocratie et l’État de droit sont menacés.
Regardez le récent arrêt climatique de la Cour d’appel de Bruxelles. Le juge a agi comme un législateur et l’a fait en utilisant une norme très générale comme le droit à la vie pour imposer une décision politique, comme si l’on ignorait toutes les politiques qui, selon nous, pourraient coûter des vies (éteindre les lumières sur les autoroutes). . , non-remboursement de certains médicaments) peuvent être interdits par les juges.
De plus, il ne peut pas être démontré que le maintien inchangé, la réduction de moitié ou même la disparition totale des 0,2 pour cent des gaz à effet de serre mondiaux émis par la Belgique font une différence dans le nombre de décès dus au climat. Ce verdict illustre à quel point la démocratie et la raison sont mises à mal. Le danger pour la démocratie est partout. Tout simplement parce que les personnes influentes ont des objectifs qu’elles considèrent si importants qu’elles justifient tous les moyens. Cela place l’Europe à la croisée des chemins.
La mondialisation néolibérale a laissé une Europe affaiblie dans un monde dangereux. L’actuelle Commission européenne s’est décrite à juste titre comme géopolitique lorsqu’elle a pris ses fonctions. Depuis lors, la nécessité d’une réflexion géostratégique est devenue encore plus impérieuse. Concrètement, le problème est de maintenir l’Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et un certain nombre de pays des Balkans hors de la sphère d’influence de la Russie et de la Chine. Sans certitude que cette voie sera couronnée de succès, le remède le plus évident semble être l’adhésion de ces pays à l’UE. Cependant, ce plan comporte une tentation de mettre de côté l’État de droit et la démocratie. L’objectif est extrêmement important… mais les électeurs peuvent le voir différemment.
L’adhésion des nouveaux États membres se fait finalement par un traité d’adhésion qui doit être ratifié en Belgique par tous les parlements concernés. La démocratie, le respect de l’électeur, commence par la politisation, en plaçant les questions qui affectent la vie des gens à l’agenda politique. Ce processus se déroule lorsque les différentes parties adoptent des positions différentes, voire contradictoires. Nous pouvons donc espérer que nos partis politiques assumeront leur tâche démocratique et politiseront l’élargissement de l’Union. Après tout, cette expansion affectera profondément la vie des États membres, sur le plan géopolitique, mais aussi budgétaire, économique, à travers les migrations intra-européennes, à travers un impact sur la politique de l’emploi, l’agriculture, etc.
Pour être viable, une Union élargie devra adapter ses méthodes de travail. Cela peut se faire en partie (par exemple en réduisant le nombre de commissaires) dans le cadre des traités actuels. Le Parlement européen souhaite cependant moins de décisions à l’unanimité au Conseil, davantage à la majorité qualifiée. Cela suppose une modification du traité. Pour les États membres, cela équivaut en fait à une modification constitutionnelle et à un nouvel abandon de la souveraineté nationale. Il n’est en aucun cas conforme à un régime constitutionnel que des changements d’une telle envergure soient approuvés à une simple majorité parlementaire, comme cela s’est produit en Belgique avec le vaste traité de Lisbonne. Un référendum constitutionnel semble approprié si un nouveau traité européen d’amendement est conclu.
Il est donc grand temps que les partis sincèrement préoccupés par la démocratie et l’État de droit s’y engagent. Cependant, de nombreux décideurs politiques européens estiment qu’une Union élargie ne peut être réalisée de manière démocratique et ne peut être réalisée que par des raccourcis juridiques, sans légitimation démocratique directe. C’est à ce carrefour que nous nous trouvons.
L’Europe, qui a déjà vaincu la réflexion brutale à deux reprises, doit désormais adopter le réalisme et apprendre à agir de manière géostratégique. S’il ne peut pas simultanément respecter et renforcer la démocratie et l’État de droit, il perdra son âme et le droit de critiquer les régimes autoritaires.