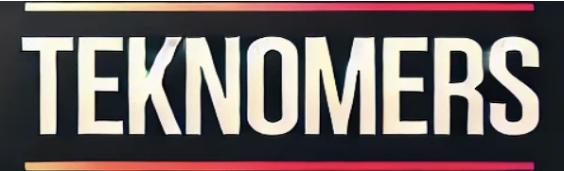Débloquez gratuitement Editor’s Digest
Roula Khalaf, rédactrice en chef du FT, sélectionne ses histoires préférées dans cette newsletter hebdomadaire.
En avril, un mois après la révélation du plus grand scandale d’abus sexuels dans l’industrie du divertissement au Japon, l’agence artistique en question a tardivement mis en place une ligne d’alerte qui permettrait aux victimes de se manifester.
La hotline présentait cependant un défaut majeur. Il n’était ouvert qu’aux employés de Johnny & Associates, ce qui signifie que les centaines de jeunes artistes indépendants qui auraient pu être maltraités par son défunt fondateur Johnny Kitagawa n’étaient pas éligibles pour utiliser le nouveau mécanisme pour déposer leurs plaintes.
Cette absence de ligne d’assistance téléphonique opérationnelle n’est que l’une des nombreuses lacunes graves des contrôles internes qui ont permis à Kitagawa, un pionnier du genre des boys band asiatiques décédé en 2019, de se livrer à des abus sexuels depuis que des allégations ont émergé dans les années 1950, selon un panel. d’experts externes mandatés par l’agence.
Mais l’incident de Johnny, ainsi qu’une série d’autres scandales récents au sein d’entreprises, ont mis en lumière la faiblesse plus large des protections juridiques accordées aux lanceurs d’alerte au Japon, ce qui a pour conséquence que les victimes souffrent en silence et que les mauvaises conduites des entreprises sont négligées bien plus longtemps qu’elles n’auraient dû l’être.
L’absence persistante de plusieurs garde-fous, disponibles aux États-Unis et en Europe, contraste avec les arguments des entreprises japonaises auprès des investisseurs étrangers qui citent l’amélioration de la gouvernance d’entreprise comme raison pour investir davantage d’argent dans le pays.
Cependant, la question devient de plus en plus importante à l’ordre du jour. Yutaka Arai, le commissaire de l’agence japonaise chargée de la protection des consommateurs, a annoncé la semaine dernière qu’il procéderait à une audition de 10 000 entreprises pour déterminer si elles disposaient de mécanismes de réclamation appropriés.
Le Japon a révisé sa loi sur la protection des lanceurs d’alerte en 2020, qui a élargi le champ d’application des critères de qualification des lanceurs d’alerte et a obligé les entreprises de plus de 300 employés à mettre en place des canaux de signalement internes. Les changements étaient importants, mais les avocats affirment que les réformes ne vont pas assez loin.
Premièrement, la définition d’un lanceur d’alerte reste étroite. Même si le champ d’application a été élargi pour inclure les anciens salariés et dirigeants, il exclut les travailleurs indépendants et les familles des salariés ainsi que les entrepreneurs et les fournisseurs, qui font tous partie des règles de l’UE.
Deuxièmement, aucune sanction pénale ou administrative n’est prévue contre les entreprises qui exercent des représailles contre les lanceurs d’alerte en licenciant ou en rétrogradant les personnes qui portent plainte. Il n’y a pas non plus de récompense financière pour les personnes qui se manifestent, comme c’est le cas aux États-Unis ou en Corée du Sud. Ceux qui subissent des représailles peuvent porter l’affaire devant les tribunaux, mais le processus prend du temps et il incombe aux lanceurs d’alerte de rassembler des preuves. En conséquence, les risques pour les employés dépassent souvent les avantages liés au signalement des fautes professionnelles en entreprise. « Même avec la révision, il n’est pas devenu plus facile de dénoncer », a déclaré Masato Nakamura, avocat et expert en protection des lanceurs d’alerte.
En vertu de la loi révisée, l’agence de protection des consommateurs peut prendre des mesures administratives légères à l’encontre des entreprises qui ne mettent pas en place de mécanismes de signalement internes. L’agence a utilisé son nouveau mandat en septembre contre Bigmotor, une chaîne de concessionnaires et d’ateliers de réparation de voitures d’occasion, qui a récemment admis avoir gonflé les réclamations d’assurance en endommageant intentionnellement les voitures amenées pour entretien. L’ordre administratif de signaler les mesures d’amélioration est intervenu après qu’un groupe d’experts externes a découvert que l’entreprise avait précédemment dissimulé une plainte déposée par le personnel de réparation pour dissimuler sa mauvaise conduite.
Toshihiro Okuyama, professeur à l’université de Sophia, estime néanmoins que l’agence, avec ses ressources limitées, pourrait exercer davantage de pression sur les entreprises si elle pouvait mettre en œuvre des mesures plus strictes, telles que des inspections sur place. Si la hotline interne n’est pas efficace, il vaudrait mieux que les lanceurs d’alerte puissent porter leur cas directement auprès des médias, mais ce n’est pas facile non plus au Japon.
Dans le cadre actuel, les seules sanctions financières pouvant être imposées concernent les personnes qui divulguent des informations confidentielles sur le lanceur d’alerte, mais les sanctions ne s’étendent pas à l’entreprise dans son ensemble. « La réalité est qu’il n’y a pratiquement aucun cas où la loi sur la protection des lanceurs d’alerte a été réellement utilisée », a déclaré Okuyama.
Un aspect positif potentiel est qu’il est possible d’apporter d’autres modifications juridiques aux sanctions en cas de représailles alors que la loi de 2020 sera finalisée au cours des deux prochaines années. En 2018, Keidanren, le groupe de pression économique le plus influent du Japon, a résisté à l’introduction de sanctions contre les entreprises afin de renforcer la protection des lanceurs d’alerte. Cette position pourrait être plus difficile à maintenir si l’administration Kishida donne la priorité à l’amélioration de la gouvernance et de la transparence des entreprises.