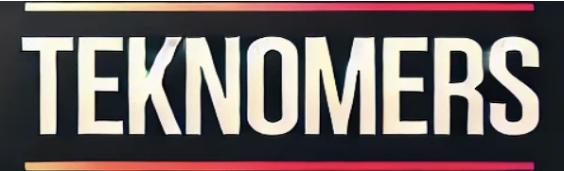Cela ne devient pas beaucoup plus symbolique que McDonald’s. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la chaîne de restauration rapide rejoint la liste croissante des entreprises qui s’éloignent de la Russie pour l’instant.
Il a évoqué pour certains des souvenirs d’un moment historique en 1990 : l’ouverture du premier McDonald’s dans ce qui était alors l’Union soviétique. Des milliers de Moscovites fait la queue pendant des heures pour un Big Mac, qui coûte rapidement au Russe moyen environ trois heures de salaire.
McDonald’s compte désormais 847 restaurants en Russie. Mardi, le PDG Chris Kempczinski faire savoir aux employés qu’ils seront tous fermés pour le moment. Kempczinski, qui subissait une pression sociale croissante pour agir, a parlé d' »une situation extraordinairement complexe » avec « de nombreux compromis », mais a finalement déclaré que l’entreprise voulait faire « la bonne chose ».
Rester en Russie ou partir ? C’est une question complexe pour les entreprises, dans laquelle l’opinion publique, les intérêts commerciaux et les responsabilités sociales sont étroitement liés. Néanmoins, une proportion croissante opte pour une sortie (partielle) de Russie. Ce n’est que ces derniers jours que cela a été le cas, par exemple, pour la banque d’investissement Goldman Sachs, la chaîne de café Starbucks, la marque de vêtements Uniqlo et le groupe automobile Stellantis, société mère de Peugeot, Citroën et Opel.
« Je vois un effet boule de neige », a déclaré Jeffrey Sonnenfeld, professeur à la Yale School of Management. Il tient une liste des grandes entreprises qui se retirent. Il y a maintenant plus de 300 noms dessus.
La position de Sonnenfeld est claire : les entreprises ont une obligation morale d’agir. « Sinon, vous garderez la façade de Poutine en place. » C’est pourquoi il cite également de grands noms qui n’ont pas (encore) franchi le pas : la chaîne de cafés et de confiseries Dunkin’ Donuts, par exemple, le manufacturier de pneumatiques Pirelli, la chaîne de sandwichs Subway. Le groupe de peinture néerlandais AkzoNobel a également annoncé vendredi qu’il resterait pour l’instant en Russie, tant que les sanctions occidentales le permettraient.
Plus d’action que prévu
Mais un grand groupe d’entreprises prend en fait une quantité remarquable d’actions, constate Sonnenfeld. Bien plus que ce qu’ils sont légalement tenus de faire en raison des sanctions. Ceci est remarquable car ces démarches ont des conséquences financières (lourdes) pour la communauté des entreprises. Voici comment McDonald’s ferait, selon des experts des médias américains Coûte 50 millions de dollars par mois de garder leurs restaurants en Russie fermés. L’entreprise elle-même ne fait aucune annonce à ce sujet, mais il n’est pas difficile de comprendre qu’elle le coupera si une chaîne doit fermer 847 succursales.
En outre, les entreprises peuvent s’attirer les foudres du président Poutine, écrit vendredi le journaliste financier Peter Coy Le New York Times† Il a déjà déclaré qu’il considérait les sanctions d’autres pays comme un « acte de guerre ». Il peut aussi se venger des entreprises, selon Coy, par exemple via des cyberattaques.
Alors pourquoi cette grande volonté de prendre position contre la Russie ? Le grand dégoût du public pour la guerre dans de grandes parties du monde joue naturellement un rôle, dit Sonnenfeld. « Les entreprises ont peur d’un boycott des consommateurs. » Mais il pense aussi que les investisseurs et les investisseurs font pression. Par exemple, le principal fonds de pension américain, qui gère 280 milliards de dollars, a exhorté la semaine dernière les entreprises à cesser de faire des affaires en Russie, a écrit le journal d’affaires de Financial Times† Bien que l’ampleur de cette pression diffère selon l’industrie.
En outre, Sonnenfeld considère les employés comme une influence importante sur la direction des entreprises, en particulier lorsque de nombreux jeunes travaillent.
L’entreprise technologique Philips, par exemple, a remarqué que les employés commençaient à s’agiter. Le groupe avait l’habitude d’adopter une « position politiquement neutre », a déclaré un porte-parole. CNRC† Mais Philips a vu que « de nombreuses questions venaient de notre propre organisation : ne devrions-nous pas adopter une position plus ferme ? Des e-mails ont été envoyés, cela a toujours été discuté lors de réunions et sur nos canaux de médias sociaux internes. Nous le voulions, mais nous n’y étions pas encore habitués. » Enfin, le PDG Frans van Houten a publié une déclaration condamnant la guerre.
Il est également compréhensible que les entreprises soient dubitatives avec ce dossier, car les critiques rôdent rapidement. Heineken en a fait l’expérience lorsque le président du conseil d’administration, Dolf van den Brink a écrit sur LinkedIn vendredi dernier autour d’un don de 1 million d’euros pour les victimes de la guerre. Aux yeux des critiques, les choses ont mal tourné deux fois : pour commencer, Van den Brink a d’abord utilisé le terme « opération militaire » au lieu de « guerre », ce qui l’a conduit à être accusé de diffuser de la propagande russe. Heineken pourrait mieux faire avec « les tripes [tonen] d’arrêter toutes les activités en Russie », comme l’a dit un lecteur.
Cette semaine, le brasseur a annoncé qu’il cesserait de vendre la marque Heineken en Russie après que des mesures encore moins drastiques avaient été annoncées quelques jours plus tôt. « Une grande décision », a déclaré un porte-parole de Heineken, même si les autres marques de bière de l’entreprise resteront disponibles. « Nous n’avons jamais décidé de retirer la marque Heineken pour des raisons géopolitiques. » L’entreprise compte sept brasseries en Russie, 1 800 employés et y réalise 2 % de son chiffre d’affaires : la marque Heineken en est « une partie importante ».
Des « premiers arrivés » surprenants
Outre le grand nombre d’entreprises prenant des mesures en Russie, Sonnenfeld a également été surpris par l’ordre dans lequel cela s’est produit. Les préoccupations qui ont été les premières à se déplacer « ne sont pas les premiers arrivés que vous attendez », dit-il.
Au lendemain de l’invasion de l’Ukraine, le 24 février, les premières à réagir ont été les compagnies pétrolières BP, Exxon et Shell (qui ont annoncé mardi rompre complètement les liens avec la Russie, après avoir initialement vendu uniquement l’activité d’exploration pétrolière et gazière). Les grandes entreprises technologiques ont rapidement suivi : Dell, puis IBM, Apple, Meta, Google, Twitter. Des prestataires de services aux entreprises tels que McKinsey, Bain, KPMG, EY, Deloitte se sont également manifestés presque simultanément. †choquant† Je fais ce métier depuis 45 ans. Et je n’ai jamais vu des entreprises comme celle-ci arriver en tête en matière de questions sociales. » Normalement, ce sont davantage les entreprises de consommation qui s’expriment sur des questions telles que le changement climatique ou les droits de l’homme, dit Sonnenfeld – si elles le font du tout.
Qu’est-ce que c’est en lui ? Les entreprises alimentaires telles que PepsiCo et Danone se disent réticentes à prendre des mesures drastiques car elles fournissent de la nourriture et des boissons aux citoyens russes : elles ont seulement toutes deux promis de ne pas faire de nouveaux investissements en Russie. PDG de Danone a dit à la semaine dernière Financial Times qu’il est « facile de tomber dans la pensée noire et blanche » mais que son entreprise porte « une responsabilité » envers les clients, les agriculteurs et les dizaines de milliers d’employés. Et PepsiCo fait une distinction au niveau des produits : il cessera de vendre des boissons, mais pas de la nourriture et des produits laitiers.
Philips suit la même voie, qui a cessé d’importer des rasoirs et des brosses à dents électriques, mais pas des produits pour bébés tels que des biberons et des tire-lait. L’entreprise fournit également du matériel médical. « La guerre en Ukraine est terrible, mais nous ne devons pas non plus perdre de vue le côté humain en Russie. »
Le professeur de Yale Sonnenfeld estime que certaines des marques de consommation bien connues craignent d’être punies par le public russe, qui a été alimenté par la propagande de Poutine et qui a peut-être été un bon client dans le passé. La marque de bijoux Bvlgari (qui fait partie de la maison de luxe LVMH) a reçu de nombreuses critiques, dont le PDG a déclaré à l’agence de presse début mars Bloomberg a confié que « le chiffre d’affaires a probablement augmenté » après le début de la guerre, parce que les riches Russes « fuyaient » dans les bijoux Bvlgari coûteux. Ce qui n’a pas aidé dans l’opinion publique, c’est qu’il a ajouté que Bvlgari « est là pour les Russes, pas pour le monde politique ». Les magasins ont fermé quelques jours plus tard.
Avec la collaboration de Teri van der Heijden et Liza van Lonkhuyzen
Une version de cet article est également parue dans NRC Handelsblad le 12 mars 2022
Une version de cet article est également parue dans NRC le matin du 12 mars 2022