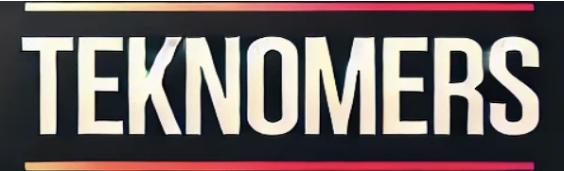Malou (21 ans) ne comprend pas exactement quel est le lien entre Starbucks et la guerre à Gaza, dit-elle dans la Leidsestraat à Amsterdam. Elle boycotte pourtant fermement la chaîne de café américaine. « Je marchais jusqu’à Starbucks hier, jusqu’à ce que je pense : oh, non, je ne vais pas faire ça. » Avant le 7 octobre, elle s’y rendait régulièrement, mais désormais elle n’en a plus le cœur. « Je pense particulièrement à ces enfants de Gaza. » Boycotter ce type d’entreprises est « la moindre des choses », estime-t-elle. Mais : « Vous continuez à vous sentir impuissant. »
Malou ne veut pas utiliser son nom de famille CNRC, en raison de la sensibilité du sujet. Cela s’applique également à de nombreuses autres personnes avec lesquelles le CNRC a parlé dans la rue commerçante.
Depuis l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre et la violente réponse militaire israélienne qui a suivi, de nombreux influenceurs et militants ont appelé au boycott des consommateurs. L’idée est la suivante : n’achetez pas de produits auprès d’entreprises qui profitent de l’occupation israélienne en Palestine ou qui contribuent d’une autre manière aux violations des droits humains des Palestiniens.
C’est ainsi que McDonald’s s’est retrouvé sur la liste de boycott, après les franchises israéliennes repas gratuits remis aux soldats israéliens. Starbucks, qui n’a plus d’établissement en Israël depuis 2003, est confronté à des boycotts parce qu’il un procès déposée contre un syndicat américain qui exprimait sa solidarité avec la Palestine (voir encadré).
« Je n’aime pas que les choix de certaines entreprises aient des conséquences pour les Palestiniens »
Les boycotts internationaux des consommateurs pro-palestiniens ne sont pas un phénomène nouveau, mais ils ont de nouveau reçu beaucoup d’attention et de soutien sur les réseaux sociaux ces derniers mois. C’est ainsi que les gens deviennent dans les vidéos TikTok encouragé manger dans des fast-foods qui « ne soutiennent pas le génocide » et prendre du café auprès d’entrepreneurs locaux qui « ne contribuent pas au nettoyage ethnique des Palestiniens ». La célèbre TikTokeuse Amanda Asad (27 ans), elle-même à moitié palestinienne, a posté une vidéo dans lequel elle recherchait des mascaras de marques qui « ne financent pas le gouvernement israélien ».
Les boycotts ont clairement un effet dans la région : en Jordanie, les canettes de Coca-Cola et de Pepsi ont été soudainement remplacées au début de cette année par des alternatives locales comme Matrix Cola de la société Defaf Al-Nahrayn. Cette entreprise jordanienne de produits alimentaires et de boissons affirme avoir doublé sa production depuis le début de la guerre à Gaza. En Égypte, les sociétés locales de boissons gazeuses Spiro Spathis et Oso Blanco gagnent en popularité dans les supermarchés et les restaurants. Coca-Cola et PepsiCo sont accusés de diriger des usines en Cisjordanie occupée et donc de se rendre complices de l’expulsion de civils palestiniens.
Tentation
« Je pense que Stradivarius est également sur la liste de boycott », déclare Morgan (14 ans) sur la Koningsplein d’Amsterdam. Elle a entre les mains un sac en papier provenant du magasin de vêtements. Elle boycotte autant que possible, dit-elle, mais parfois la tentation est trop grande. «Je viens de voir une jolie chemise et elle était tellement bon marché… Mais j’essaie de l’éviter.» Morgan tente également d’arrêter ses achats chez Zara, boycottée en raison d’une campagne publicitaire avec des mannequins enveloppés dans des draps blancs. Et ni chez McDonald’s ni chez Starbucks (« c’est aussi bon pour mon portefeuille »). Même si elle venait d’aller chez Zara.
Son amie Zoë (14 ans) s’en préoccupe moins. «Je veux juste acheter des vêtements dans les magasins que j’aime. Peut-être que je devrais y prêter plus d’attention, car c’est vraiment important.
Pour certains consommateurs, avoir des succursales en Israël est déjà une raison pour boycotter une chaîne. Ce n’est pas illogique, dit Pelle Göbel (20 ans), assis sur un banc improvisé chez Zara, dans la Kalverstraat. En créant une entreprise en Israël, vous favorisez l’économie du pays, qui finance aussi indirectement la guerre, explique-t-il. Son ami Job Duker (20 ans), qui tient un T-shirt à imprimé graphique, acquiesce.
Les hommes eux-mêmes ne participent pas aux boycotts. Pas encore. « En fait, je devrais le faire », dit Duker. Il ne savait pas que le magasin dans lequel il se trouve actuellement était également boycotté. « C’est un certain laxisme. Je pense juste : j’ai besoin de vêtements, alors j’irai chez Zara.
Selon Desaya (23 ans), « les photos publicitaires avec les mannequins montrent clairement que Zara est pro-israélien » – Zara a depuis retiré sa campagne. Elle « n’y fait en fait plus ses achats ». Parfois, elle s’inspire de la collection, puis recherche des articles similaires chez une autre marque.
Son amie Anisha (23 ans) évite les achats directs auprès de la chaîne. « Je regarde juste Vinted. » Anisha remarque que beaucoup de gens disent que le boycott ne sert à rien. « Je ne pense pas que ce soit la bonne état d’esprit est. » Selon elle, le boycott n’est pas une question économique, mais morale. « Cela ne me convient pas que les choix de certaines entreprises aient des conséquences sur ce qui arrive aux Palestiniens. »
Anti-apartheid
Même si les boycotts pro-palestiniens ont gagné du terrain depuis le 7 octobre, leurs origines remontent plus loin. Le soi-disant mouvement BDS (Boycotts, désinvestissements, sanctions) appelle depuis 2005 les gens à se retourner contre les entreprises, les gouvernements, les institutions universitaires et autres organisations qui soutiennent Israël dans « l’oppression » des Palestiniens. Le mouvement est une initiative de 171 organisations palestiniennes et s’inspire du mouvement international anti-apartheid qui, avec ses boycotts économiques et diplomatiques, a joué un rôle crucial dans l’abolition du régime de l’apartheid en Afrique du Sud en 1990.
Le mouvement BDS se concentre sur un certain nombre d' »objectifs stratégiques », indique le site Internet, comme HP, Siemens et Puma. Nicole Hollenberg, présidente de BDS Pays-Bas, explique par téléphone : « Si vous vous concentrez sur trop d’entreprises, vous perdez de l’impact. » Mais Hollenberg ne désapprouve pas le fait qu’une entreprise comme Zara soit boycottée en masse sans que le mouvement BDS ne l’appelle. «C’est une forme d’activisme. Les gens sont furieux de ce qui se passe, ils veulent faire quelque chose. Et oui, je pense que Zara va désormais y réfléchir à deux fois avant de lancer une telle campagne. » Les boycotts des consommateurs visent principalement à nuire à l’image, explique Hollenberg.
Les conséquences financières des boycotts des consommateurs prennent désormais des proportions graves. Le PDG de McDonald’s, Chris Kempczinski, a déclaré en mars que la guerre avait un effet « décourageant » sur les ventes. Cela est visible dans les pays du Moyen-Orient, dans des pays comme l’Indonésie et la Malaisie, où la majorité de la population est musulmane, et dans les pays comptant une importante communauté musulmane comme la France. Cet effet est suffisamment important pour compenser la hausse des ventes en Europe, au Japon et en Amérique latine. Après cette annonce, McDonald’s a perdu 7 milliards de dollars en valeur marchande en quelques heures. Depuis, le titre a encore baissé.
Starbucks considère le boycott comme un risque commercial sérieux. « Les boycotts ou les campagnes publiques négatives » pourraient avoir un « impact négatif » sur « la valeur de notre marque ».
« La popularité des marques américaines associées, à tort ou à raison, au soutien à Israël a considérablement diminué au Moyen-Orient depuis le déclenchement de la guerre à Gaza », a déclaré Stefanie Hausheer Ali, chercheuse à l’Atlantic Council, un groupe de réflexion américain dans le domaine international. rapports. « Tout comme les manifestations étudiantes, le mouvement de boycott vise également à mettre un terme aux investissements en Israël, car ils seraient utilisés à des fins militaires ou conduiraient à des violations des droits de l’homme. »
La question est de savoir si, comme c’est souvent le cas dans les boycotts, il s’agit d’un effet temporaire. «Je m’attends à ce que ces marques en ressentent l’impact dans les années à venir», déclare Hausheer Ali. « Parce que les habitudes des consommateurs changent vraiment en raison des opinions bien arrêtées que beaucoup de gens ont sur cette question. »
Gertjan Hoetjes, expert du Moyen-Orient à l’Université d’Amsterdam, s’attend également à un effet plus durable. Il rappelle les récentes conclusions de Francesca Albanese, rapporteure de l’ONU pour les territoires palestiniens. Albanese a « des raisons raisonnables de croire que le seuil du génocide a été atteint par Israël », écrivait-elle fin mars. Hoetjes : « Les précédents boycotts des consommateurs dans la région, par exemple contre les produits danois et français, ont souvent été de courte durée. Ce qui se passe à Gaza est d’un tout autre ordre.»
Dans le magasin H&M de la Kalverstraat, Desiree Wong Lun Hing (60 ans) tient dans les mains un chemisier blanc à fleurs colorées qu’elle vient de prendre sur un portant. « Le boycott a-t-il un sens ? Je ne le sais pas vraiment. Mais le degré d’efficacité n’a peut-être pas d’importance non plus : « Vous le faites davantage pour votre propre état d’esprit, je pense. »
Ce H&M est également boycotté, Wong Lun Hing ne le savait pas. Elle reste silencieuse un instant. « Oui… C’est stupide de fermer les yeux sur ça. » Elle raccroche le chemisier.