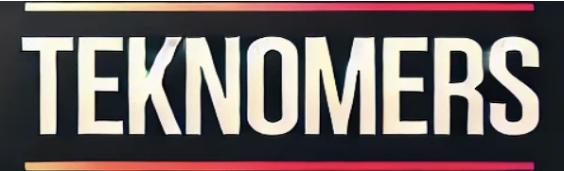L’écrivain est président du Nigeria
Les Nigérians ont été ravis d’apprendre cet été que 72 artefacts, connus sous le nom de Bronzes du Bénin, détenus par le Horniman Museum de Londres, rentraient chez eux, 125 ans après avoir été pillés par les troupes britanniques. La clameur du rapatriement des trésors pillés devient irrésistible.
Il y avait une fois une clameur similaire pour le retour des actifs volés de l’Afrique, et je vois les deux comme faisant partie de la même lutte pour ramener au Nigeria ce qui nous revient de droit. Siphonnés du continent par d’anciens dirigeants corrompus, d’innombrables milliards restent cachés dans des comptes bancaires occidentaux. Bien que le Nigeria ait sans doute été le pays africain qui a le mieux réussi à récupérer l’argent volé, il n’a récupéré qu’une fraction de ce qui reste à l’ouest.
Plus tôt cette année, le Nigéria a été contraint d’intenter une action en justice contre la National Crime Agency du Royaume-Uni, après des retards répétés dans le retour de l’argent sorti du pays dans les années 1990 par l’ancien dictateur général Sani Abacha. Cependant, l’affaire judiciaire révèle l’ampleur de la contestation devant nous. On pense qu’Abacha a détourné jusqu’à 5 milliards de dollars vers l’ouest. Cette affaire ne concernait que 150 millions de livres sterling.
Compte tenu des niveaux de corruption à travers l’Afrique, on se demandera si les fonds restitués seront utilisés de manière appropriée. Mais n’oublions pas que c’est par l’intermédiaire des juridictions occidentales que l’argent a été blanchi en premier lieu. Ne pas faire confiance aux Africains pour dépenser leur propre argent correctement fait écho à l’argument selon lequel on ne peut pas nous faire confiance pour prendre soin de notre propre patrimoine culturel.
Dans le cas du patrimoine culturel pillé et des biens volés, les musées et les autorités occidentales semblent largement d’accord sur le fait que le butin devrait, en principe, être restitué. Cependant, les détails techniques du rapatriement laissent beaucoup de place au maintien du statu quo.
Les musées disent que les trésors doivent être rendus s’il peut être prouvé qu’ils ont été pillés. Bien entendu, selon eux, la question est différente si les artefacts ont été acquis par le biais d’achats et d’autres moyens légitimes. Mais ce sont les mêmes musées qui sont chargés d’évaluer la provenance des artefacts. Ils ont tout intérêt à les conserver, encourageant une approche nonchalante et des critères obscurs.
En 2025, un nouveau musée ouvrira ses portes pour mettre en valeur les trésors du Royaume du Bénin. Conçu par l’architecte ghanéen-britannique David Adjaye, le musée d’art ouest-africain d’Edo siégera à Benin City, l’ancienne capitale du royaume d’Edo. Mais sans le retour de plus de bronzes détenus à l’ouest, nous risquons de peiner à remplir le musée.
Le Nigéria a également un déficit d’infrastructures à combler, comme l’ont souligné la Banque mondiale et d’autres institutions internationales de développement. Bien que mon administration ait entrepris le plus grand programme d’infrastructures depuis l’indépendance de notre pays, le blocage du rapatriement des avoirs volés détenus dans l’ouest rendra difficile le financement de nouveaux projets qui contribuent à réduire la pauvreté.
En 2017, la Suisse a reversé 321 millions de dollars au programme d’investissement social du Nigéria pour financer le filet de sécurité sociale national. Sous la surveillance de la Banque mondiale, l’argent a maintenant été versé sous forme de transferts monétaires conditionnels à 1,9 million de citoyens nigérians les plus vulnérables.
Trois ans plus tard, les États-Unis et la dépendance britannique de l’île anglo-normande de Jersey ont rendu 311 millions de dollars au Presidential Infrastructure Development Fund, géré par la Nigeria Sovereign Investment Authority. Les premiers projets financés par le fonds, autoroutes et ponts, devraient être achevés plus tard cette année.
Avec les actifs volés, les moyens précis par lesquels les institutions restituent ces fonds – qu’elles les remettent à l’État, à un gouvernement, à un fonds ad hoc ou à un autre organisme – suscitent des discussions sans fin plutôt qu’une action. Nous savons que la corruption persiste en Afrique, comme dans le monde entier. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre que des « progrès » non spécifiés soient réalisés avant que cet argent ne soit débloqué.