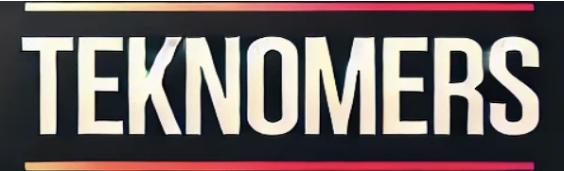« Quand je suis né, mon père était vendeur de voitures dans un grand concessionnaire automobile de Sibolga. C’est une ville portuaire du nord de Sumatra. Il y avait beaucoup de gens riches là-bas qui avaient des plantations de caoutchouc, par exemple. Mon père lui-même venait de Pasoeroean dans l’est de Java et ma mère d’Arnhem. La famille de mon père était assez mixte. Là tu avais un Pim blanc et un Pim noir : toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Quoi qu’il en soit, quand j’avais un an, nous avons dû déménager à Batavia à cause de la crise mondiale. Les prix du caoutchouc avaient chuté, plus personne n’achetait de voitures. Mon père avait trouvé un travail de comptable : à Petodjo, la fabrique de glaces. Nous nous sommes retrouvés dans le quartier du même nom, un quartier très mixte.
La rue s’est épuisée
Je n’ai jamais vraiment eu l’impression qu’il y avait de la ségrégation raciale. Il y avait une unité dans notre rue, tous les enfants de n’importe quelle couleur jouaient les uns avec les autres. Et notre personnel, le fidèle babu Idjah et le garçon d’intérieur Kinang, faisaient partie de la famille. C’est devenu bizarre plus tard, ici aux Pays-Bas. Quand je suis allé à la boulangerie à Eindhoven, toute la rue s’est avérée jeter un coup d’œil.
Quoi qu’il en soit, il y avait la guerre avec le Japon. Le 9 mars 1942, nous apprîmes que les Pays-Bas avaient capitulé. Quelques jours plus tard, nous avons vu des Japonais rouler à bicyclette. Mon père avait déjà été appelé sous les armes et était entre-temps devenu prisonnier de guerre. Avec ma mère, je suis retourné lui rendre visite à Bandoeng. Il se tenait loin avec tous les autres prisonniers derrière des barbelés. Têtes rasées. Nous ne pouvions parler qu’avec des gestes.
Quelques mois plus tard, nous avons dû déménager de notre maison. Le Jap voulait transformer notre rue en bordel. Pour notre propre sécurité, nous avons eu la possibilité de vivre à Tjideng, qui était une « zone protégée ». Mais ce quartier s’est vite transformé en camp de concentration. Deux fois par jour le matin et le soir à six heures, il fallait téléphoner. Tout le camp, les tout-petits, tout le monde. Ce que j’ai toujours admiré, c’est la façon dont les tout-petits se tenaient parfaitement en ligne. Parce qu’ils savaient que s’ils étaient ennuyeux, maman serait touchée. Oh malheur, si ça ne s’est pas bien passé. Ensuite, nous avons été punis. Nous avons été sans nourriture ni boisson pendant trois jours et trois nuits. Comme punition.
Sonei, le commandant du camp, était cruel et fou. À la pleine lune, nous devions également appeler au milieu de la nuit.
C’est mon père!
J’ai récemment vu un documentaire et j’ai dû repenser à l’époque d’après-guerre, lorsque les pères sont revenus. Eh bien, tous les enfants ont sauté dessus : c’est mon père ! Non, c’est mon père ! Et puis ces hommes s’y sont promenés avec deux enfants sur les bras et trois sur leur pantalon. Mais oui, souvent ces enfants n’avaient plus de père, car il était maintenant mort. A l’inverse, j’ai aussi vécu qu’une fille disait : ce n’est pas mon papa. Drames.
Mon propre père est revenu un beau jour. Je l’ai reconnu immédiatement. Seulement sa voix, ma mère et moi avons dû nous habituer à ça. Nous les avions perdus. Lorsque mon père est parti pour la dernière fois au début de la guerre, ma mère lui avait offert un petit flacon à bouchon à visser. Elle y avait préparé une sorte de sambal goreng. Petit poisson salé, accompagné de chips de pommes de terre frites et frit au sambal. Agréable à manger avec du riz. Il a sorti cette bouteille. « Regarde, ce qu’il me reste. » Il l’a gardé pendant trois ans. Malgré toute la faim dans les camps, il n’y avait pas touché. Après cela, il est resté pour toujours.
Photo Frank Ruiter