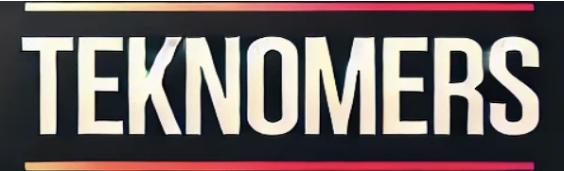Restez informé avec des mises à jour gratuites
Inscrivez-vous simplement au Vie et arts myFT Digest – livré directement dans votre boîte de réception.
L’astuce, lorsque l’on traverse la route à Hanoï, est d’éviter les mouvements brusques ou les pauses. Dans le même temps, une inconscience totale du trafic n’est pas non plus recommandée. Alors, qui a la priorité ? Le piéton, bien sûr, qu’il faut contourner. Mais aussi l’automobiliste, du moins celui qui roule sur deux roues, dont le statut impérial ne s’arrête pas au trottoir. C’est une chose « et », pas une chose « ou ».
Mais alors qu’est-ce qui n’est pas là ? C’est la République Socialiste du Vietnam et un signataire prolifique d’accords de libre-échange. (Un Hô Chi Minh serein me regarde depuis les billets de banque avec lesquels je règle une note de bar. Au bout de la rue se trouve un Bang & Olufsen.) Ce talent de vivre dans deux mondes mentaux en même temps va jusqu’au sommet.
Si l’Asie du Sud-Est est la charnière de la lutte entre les États-Unis et la Chine, le Vietnam a tout à fait raison de prétendre être la charnière de cette charnière. En 2023, le Lowy Institute de Sydney estimait qu’aucun État de la région n’était plus à égale distance entre les deux puissances – diplomatiquement, culturellement, militairement, commercialement – à l’exception de Singapour, qui compte 5 millions d’habitants contre près de 100 millions pour le Vietnam, et les Philippines, qui ont depuis lors une population de 5 millions d’habitants. incliné vers l’ouest sous Ferdinand Marcos Jr. La Thaïlande était au niveau du Vietnam en tant que gardien de la clôture. Le reste de la région ? De plus en plus imprégnée de Chine.
Si le siècle dernier a été celui des idées absolues – Eric Hobsbawm l’a appelé « l’âge des extrêmes » – celui-ci met à l’épreuve presque la faculté intellectuelle opposée : celle du doute et de la modulation plutôt que de l’engagement. Alors que les États-Unis sont loin de leur part maximale dans la production mondiale et que la Chine représente moins que cela, une grande partie de la planète pourrait être viablement « non alignée » au point de rendre le terme lui-même redondant.
Mais pas sans efforts. Un état d’esprit difficile à atteindre est celui que John Keats a décrit comme une « capacité négative ». Il s’agit d’une tolérance et même d’une préférence active pour la nuance. (F Scott Fitzgerald a appelé cela la détention de « deux idées opposées » à la fois, bien que la citation complète ait une maladresse qui ne lui ressemble pas.) On dit que c’est une marque d’intelligence. Ce n’est pas le cas. Beaucoup d’esprits de premier ordre sont dogmatiques. Mais ça est un test de courage : de sa volonté de naviguer dans la vie sans la carte rassurante de la doctrine.
Le bon et l’ambigu ont tendance à coïncider. Les villes non planifiées sont plus séduisantes, du moins pour moi, que celles basées sur un réseau ou architecturalement cohérentes. En art, pratiquement la définition du mal, du hackery, est un travail dont le sens est trop clair. Les meilleures romances peuvent être difficiles à situer sur le spectre allant du rendez-vous amoureux du jour au lendemain au couple pur et simple : suffisamment longues pour que les deux personnes se lient, mais pas assez longues pour que l’ennui mutuel s’installe. Pourtant, dans chacun de ces cas, le doute peut être intolérable. , aussi. (Pensez à l’aversion populaire pour l’art non figuratif, ou à l’éternel refrain de « Où cela va-t-il ? ».) Il existe une demande de choses sûres au milieu du flux de l’expérience humaine.
Considérons maintenant à quel point cette demande est encore plus forte lorsque les enjeux sont géopolitiques. Considérez à quel point il est plus difficile de rester ambigu. Plus le temps passe depuis le Brexit, plus je suis impressionné par les quatre décennies qui l’ont précédé. Quel acte de capacité négative cela a été, à l’échelle nationale, d’être dans l’UE mais pas tout à fait, de co-écrire le marché unique mais de s’abstenir de l’euro, d’observer la libre circulation mais pas Schengen. En fin de compte, la pression d’habiter ces demi-mondes était trop forte, et la Grande-Bretagne préférait quelque chose de pire mais de plus clair. Ce choix est plus facile à comprendre maintenant. Mais cela me rend d’autant plus curieux de connaître les pays qui parviennent à maintenir leur sang-froid, surtout si les forces qui tentent d’obtenir leur engagement sont plus intimidantes que Bruxelles.
Parfois, dans la circulation à Hanoï, on entend ce symbole d’une nation non alignée en 2024 : les voix russes ambiantes. Je m’envole en me demandant si elle peut durer, cette masterclass sur le fait de ne pas choisir, entre le marché et l’État, entre l’Occident et ses rivaux, jusqu’à l’ancienne question, encore brûlante dans le monde de la stratégie, de savoir si le Vietnam doit avoir un système continental ou maritime. orientation. Son expérience de l’invasion territoriale suggère la première. Quelque 2 000 milles de côtes suggèrent la seconde. L’argent dépensé pour un char n’est pas dépensé pour un navire. Même en Asie du Sud-Est, il y a une limite à ce qu’on peut « et » au monde.
Envoyez un e-mail à Janan à [email protected]
Découvrez d’abord nos dernières histoires — suivez @FTWeekend sur Instagram et Xet abonnez-vous à notre podcast Vie et art partout où tu écoutes