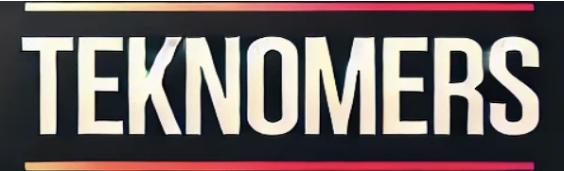Le 1er juillet approche, et cela signifie Keti Koti, et cela signifie l’été. La ville que ma fenêtre donne scintille au soleil. C’est comme un souvenir que j’arrive à revivre. La reconnaissance réside dans la cime des arbres qui éclatent en mille nuances de vert, dans les rires des gens dans la rue, les klaxons chauffés dans la circulation.
Un garçon passe de l’autre côté du canal. Il porte une minijupe noire et des bottines dorées à talon.
Mon téléphone sonne, je me permets de ne pas répondre. Je reçois beaucoup d’appels pendant cette période. Ou je veux venir parler, réfléchir, écrire sur l’année de commémoration de l’esclavage. Ils me demandent pourquoi c’est important, la commémoration. Poser la question, c’est y répondre, nous le savons tous. Oui, il est important que nous continuions à nous parler, et que nous nous souvenions ensemble. Parce que dans cette conversation et dans cette convivialité, quelque chose comme une société surgit.
Un message enregistré sur ma messagerie vocale ; si je peux venir au studio pour parler d’Anton de Kom et de sa réhabilitation. Je ne peux pas, l’agenda est trop chargé. D’ailleurs, mais je ne dirai pas ça, je ne veux pas. J’ai écrit un roman sur De Kom il y a dix ans. J’ai rampé dans sa peau, j’ai essayé de voir le monde tel qu’il aurait pu le voir. J’ai essayé de le faire vivre pour tous ceux qui ne le connaissaient pas (il y en avait beaucoup à l’époque).
Lorsque le livre est sorti, il y a eu des éloges aux Pays-Bas. Les critiques sont venues du Suriname, car j’avais fait jouer le livre dans l’institution psychiatrique où De Kom avait été hospitalisé pour une courte période. Inapproprié, disaient-ils. Méchant et blessant. Les problèmes mentaux étaient une forme de faiblesse. Et la faiblesse ne se mélangeait apparemment pas avec l’héroïsme. Le commentaire qui m’a le plus touché : “C’est ce que vous obtenez quand ils commencent à écrire sur nous.” “Ils” étaient hollandais. C’était moi. “Nous”, c’étaient des Surinamais. Ce n’était pas moi.
J’ai réalisé; si la commémoration est une conversation, alors je n’ai pas été invité ici.
J’appelle le studio pour dire que je n’ai pas le temps de parler de De Kom. Et que j’espère qu’ils trouveront quelqu’un d’autre (quelqu’un qui se souvient d’une manière plus appropriée que moi, je pense, mais je ne dis pas ça non plus).
Après avoir raccroché, je regarde un moment dehors.
Le garçon est presque hors de ma vue. Je distingue à peine ses longs cheveux raides, la courte jupe plissée qui se termine bien au-dessus de ses genoux. Ses pattes sont longues et fines.
Je l’admire et je suis inquiet. Souhaitez-lui silencieusement bonne marche, espérez qu’aucun regard hostile ne lui sera lancé, aucune violence, aucune vengeance pour ce qu’il imagine.
Keti Koti, je pense maintenant, coïncide avec la fin du mois de la fierté. Le mois au cours duquel les droits et la beauté de l’être humain queer sont célébrés cède la place à la commémoration de toutes les personnes qui ont été niées à la suite de l’esclavage. Des gens comme Anton de Kom : des héros qui nous ont été vendus comme une menace pour la sécurité nationale. Comme ce garçon est un héros à sa manière, et sa résistance capricieuse est encore caractérisée par trop de gens comme dangereuse, superflue, anormale. Avec toutes ses conséquences.
Commémorer et célébrer est toujours si nécessaire à tant de niveaux. C’est en fait une conversation continue sur qui nous étions et qui nous voulons être. Une conversation dans laquelle nous ne serons généralement pas d’accord. A propos de savoir si un homme en jupe offense ou non. Ou comment écrire sur les héros, par exemple.
Karin Amatmukrim est écrivain et homme de lettres. Elle écrit une chronique ici toutes les deux semaines.
Une version de cet article est également parue dans le journal du 27 juin 2023.