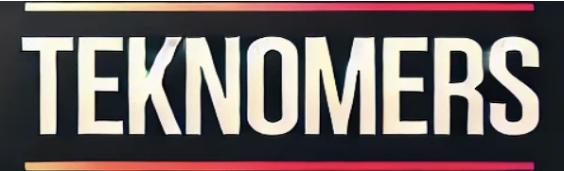Débloquez gratuitement Editor’s Digest
Roula Khalaf, rédactrice en chef du FT, sélectionne ses histoires préférées dans cette newsletter hebdomadaire.
L’idée sous-jacente de la démocratie – selon laquelle les gouvernements sont responsables envers les gouvernés – est toujours valorisée dans de nombreuses régions du monde. Comment expliquer autrement que plus de la moitié de la population mondiale votera cette année ? Pourtant, le monde a également été dans une situation Larry Diamond, de l’Université de Stanford, parle de « récession démocratique » depuis près de deux décennies. Le pouvoir de la Chine autocratique s’est accru. Vladimir Poutine a étranglé la démocratie en Russie. L’autoritarisme triomphe dans de nombreux pays. La réélection de Donald Trump, après sa tentative de renverser le résultat de la dernière élection présidentielle américaine, constituerait également un changement décisif pour la démocratie la plus influente du monde.

Pourtant, ce qui se passe n’est pas essentiellement une perte de confiance dans les élections elles-mêmes. Après tout, les autoritaires utilisent souvent les élections pour consacrer leur pouvoir. Comme le soutient Francis Fukuyama dans son récent livre, Le libéralisme et ses mécontentements« [I]Ce sont les institutions libérales qui ont été immédiatement attaquées. Il fait ici référence aux principales institutions contraignantes : les tribunaux, les bureaucraties non partisanes et les médias indépendants. Nous assistons à une perte de confiance dans le libéralisme, cet ensemble de convictions qui semblaient si triomphantes après la chute de l’Union soviétique.
Qu’est-ce alors que le libéralisme ? J’en ai parlé dans une tribune publiée à l’été 2019, en réponse à une affirmation de Poutine selon laquelle « la soi-disant idée libérale… . . . a dépassé son objectif ». Le libéralisme, ai-je soutenu, n’est pas ce que les Américains pensent habituellement, parce que l’histoire de leur pays est unique. Ce que partagent les libéraux, c’est la confiance dans les êtres humains pour qu’ils décident eux-mêmes des choses. Cela implique le droit de faire ses propres projets, d’exprimer ses propres opinions et de participer à la vie publique.
Une telle capacité à exercer son action dépend de la possession de droits économiques et politiques. Des institutions sont nécessaires pour protéger ces droits. Mais une telle action dépend également des marchés, pour coordonner les acteurs économiques, des médias libres, pour débattre de la vérité, et des partis politiques, pour organiser la politique. Derrière ces institutions se cachent des valeurs et des normes de comportement : un sentiment de citoyenneté ; la croyance dans la nécessité de tolérer ceux qui diffèrent de soi ; et la distinction entre gain privé et objectif public nécessaire pour lutter contre la corruption.
Le libéralisme est une attitude et non une philosophie complète du monde. Il reconnaît les conflits et les choix inévitables. Elle est à la fois universelle et particulière, idéaliste et pragmatique. Il reconnaît qu’il ne peut y avoir de réponse définitive à la question de savoir comment les humains doivent vivre ensemble. Pourtant, il existe encore des principes sous-jacents.
Les sociétés fondées sur les principes libéraux sont les plus prospères de l’histoire du monde. Mais eux et leurs idées sont également confrontés à des difficultés.
Comme l’a noté le Centre pour l’avenir de la démocratie dans un rapport publié fin 2022, l’invasion russe a galvanisé le soutien à l’Ukraine parmi les démocraties libérales occidentales. Mais c’est le contraire qui s’est produit dans une grande partie du reste du monde. « En conséquence, la Chine et la Russie devancent désormais de peu les États-Unis en termes de popularité parmi les pays en développement. » Cela donne sûrement à réfléchir. De plus, ajoute le rapport, basé sur des enquêtes portant sur 97 pour cent de la population mondiale, cela « ne peut pas être réduit à de simples intérêts économiques ou à des commodités géopolitiques. Il s’agit plutôt d’une division politique et idéologique claire. Partout dans le monde, les indicateurs les plus puissants de l’alignement des sociétés . . . sont leurs valeurs et institutions fondamentales – y compris leurs croyances en la liberté d’expression, le choix personnel et la mesure dans laquelle les institutions démocratiques sont pratiquées et perçues comme légitimes.

Une façon intéressante de voir les choses est fournie par le «Carte culturelle d’Inglehart-Welzel», tiré de l’Enquête sur les valeurs mondiales. Il cartographie les valeurs selon deux axes : l’un montre l’accent mis sur « l’expression de soi » par rapport à la « survie », l’autre montre l’accent mis sur les valeurs « laïques » par rapport aux valeurs « traditionnelles ». Il convient de noter que les différentes régions du monde se trouvent dans des endroits très différents. L’accent mis sur l’expression de soi (une valeur libérale fondamentale) est relativement élevé en Europe occidentale et dans les pays anglophones, les pays africains-islamiques se trouvant à l’opposé. Il est intéressant de noter que les sociétés « confucéennes » sont plus élevées que les États-Unis en matière de valeurs laïques et contraires aux valeurs traditionnelles. Le point important, cependant, est que les différences de valeurs sont profondes. Certains aspects du libéralisme – le libre marché, par exemple – se propagent assez facilement, mais d’autres – l’évolution des normes de genre, par exemple – ne le font pas.

Pourtant, la résistance au libéralisme n’est pas évidente qu’à l’étranger. C’est aussi domestique. Fukuyama montre, par exemple, comment la gauche progressiste et la droite réactionnaire s’accordent sur le caractère central des identités de groupe dans la politique américaine. Ils conviennent également que leurs divergences portent sur les groupes qui détiennent le pouvoir plutôt que sur la meilleure façon de créer l’égalité des chances pour les individus. Mais les conflits pour le pouvoir sont un jeu à somme nulle. De plus, la gauche « progressiste » semble avoir oublié que, dans une guerre identitaire, les minorités sont presque certaines de perdre. Pourquoi ces activistes sont-ils incapables de comprendre cette évidence ?
Alors que le libéralisme est en difficulté non seulement à travers le monde, mais même dans ses régions centrales, il est facile de croire que l’avenir repose sur des politiques autoritaires et des valeurs sociales traditionnelles. Si tel est le cas, ce siècle pourrait faire écho au précédent, mais sans la ferveur révolutionnaire de cette époque. L’attrait du « grand leader » qui prendra tout sur lui semble éternel. Il en va de même pour le confort du tribalisme, des hiérarchies traditionnelles et des vérités anciennes. Il en va de même pour le charisme du prophète révolutionnaire qui promet de transformer une société pour le mieux. Les conflits autour du pouvoir et des modes de vie sont inévitables.
De plus, la liberté impliquera toujours des choix difficiles. C’est forcément limité. Cela signifie responsabilité, anxiété et insécurité. Pourtant, la liberté est précieuse. Il faut le défendre, aussi difficile que puisse être cette tâche.
Suivez Martin Wolf avec monFT et sur X