Chaque été, alors que les obsédés de la photographie débarquent dans la ville provençale d’Arles, ses élégants murs de pierre calcaire disparaissent sous un kaléidoscope d’affiches : flyers pour des défilés marginaux, comptes Instagram d’artistes essayant d’accrocher un commissaire d’exposition parisien en visite, codes QR faisant la publicité de livres photo, invectives contre les sponsors d’entreprise.
Cette année, ce sont les pancartes électorales qui étaient partout. Le second tour des élections législatives anticipées en France a coïncidé avec la fin de la semaine d’ouverture ; l’espace sous l’un des lieux avait été transformé en bureau de vote. « Marseille emmerde le Front national » pouvait-on lire sur un tract près de la gare. Aucune traduction n’est nécessaire.
Le plus curieux, c’est que malgré les plus de 40 expositions proposées cette année aux Rencontres d’Arles (dont plusieurs à l’échelle d’un musée), il était difficile de trouver un aperçu du psychodrame sans fin de la politique de l’ère Macron. Alors que les artistes et les commissaires d’exposition français sont plus présents que jamais, les aperçus de la France elle-même semblent coincés dans l’aspic. Des photos historiques en noir et blanc de pétanque les allumettes remplissent le musée de la ville ; une exposition soutenue par la SNCF dans la minuscule salle Croisière est consacrée aux images d’archives des wagons-restaurants (serveurs aux favoris extravagants, sandwichs minables).
Un cynique pourrait penser que le monde culturel français ne souhaite pas trop s’intéresser à ce qui se passe actuellement dans le pays, par peur de ce qu’il pourrait y découvrir. Peut-être que l’aspic raconte sa propre histoire.
Mais les psychodrames des autres pays ? Inévitables, que vous vous intéressiez à Beyrouth (Randa Mirza), aux États-Unis de Trump (Debi Cornwall) ou à la Syrie (Stephen Dock). Cette attention portée aux troubles mondiaux ne s’apparente pas toujours à un déni des problèmes nationaux ; elle semble parfois être une façon de parler de ces mêmes problèmes sous un angle différent. L’une des expositions marquantes du festival, Voyage au centremagnifiquement installé dans la voûte aérée de l’Église des Frères Prêcheurs, est de la photographe de Magnum Cristina de Middel, mieux connue pour Les Afronautes (2012), qui documente la tentative excentrique d’un professeur de sciences zambien dans les années 1960 de former le premier équipage spatial africain. Le dernier projet pluriannuel de De Middel utilise également le côté ludique pour enquêter sur l’un des grands sujets de notre époque, en se concentrant sur le parcours des migrants de Tapachula au Mexique jusqu’aux États-Unis.

Au lieu de présenter ce voyage comme une « crise » frontalière causée par des « clandestins » sans visage, elle le présente comme une quête héroïque à la manière de Tolkien ou de Jules Verne, en le peuplant des personnes et des histoires qu’elle a rencontrées en chemin. Sur une image, une jeune femme se tient près d’une section de la clôture frontalière, portant un sweat-shirt orné du visage orange furieux de Donald Trump. Sur une autre, un membre de l’Athletic Club de Tijuana s’entraîne au saut à la perche sur une plage à côté du mur (si seulement traverser la frontière était aussi facile).

Beaucoup de ces photographies ont un côté fantastique et surréaliste qui nous fait nous demander s’il s’agit de documentaires ou de quelque chose de plus artificiel. Mais d’autres expositions ici sont d’une réalité mortelle : dans une vitrine, de Middel rassemble des images en noir et blanc d’effets personnels retrouvés sur les corps de personnes mortes en tentant de traverser le désert du sud de l’Arizona. Un portefeuille en plastique ne contient guère plus qu’une icône religieuse, de la monnaie et du dentifrice. « Non identifié », peut-on lire sur l’étiquette.
Les femmes photographes sont très présentes dans la programmation d’Arles cette année, plus nombreuses et dans des espaces plus vastes que je ne me souviens. On y trouve une généreuse rétrospective de la portraitiste américaine Mary Ellen Mark et une exposition concentrée mais puissante d’Ishiuchi Miyako consacrée à des images poignantes et rapprochées des effets personnels de personnes décédées (parmi ses sujets figurent sa mère et Frida Kahlo).

Mais pour moi, le point culminant a été une exposition collective consacrée aux femmes photographes japonaises des années 1950.Je suis si heureuse que tu sois là. Bien que le pays possède l’une des scènes photographiques les plus dynamiques au monde, seule une poignée des artistes présentés ont été exposés à l’échelle internationale ; un seul, la talentueuse coloriste Rinko Kawauchi, a été exposé au cours des 54 ans d’histoire d’Arles.
C’est une véritable fête : 26 artistes, sept décennies, une débauche de styles bruyants. La grand-mère de tous, Toyoko Tokiwa (1928-2019), est à juste titre honorée dans la salle d’ouverture, représentée par son courageux livre photo Kiken à Adabana (Fleurs vénéneuses1957), qui a fait scandale en éclairant la vie obscure des travailleuses du sexe dans le Yokohama d’après-guerre. Mais les révélations abondent. Toshiko Okanoue, à qui on a permis une brève carrière dans les années 1950 avant qu’elle ne soit interrompue par un mariage, a produit des collages sournois et épurés dignes de Dora Maar ou Hannah Höch ; elle n’a été découverte que récemment.

Quatre décennies plus tard, Hiromi Toshikawa, qui s’est rebaptisée Hiromix, a choqué la scène photo masculine japonaise des années 1990 avec ses photos décalées, souvent floues (chats, selfies, paysages urbains délirants, couleurs migraineuses). À l’époque, on les qualifiait avec mépris de « photos de filles ». Mais elles vous arrêtent toujours net, plus sales et bien plus dangereuses que les kawaii la gentillesse dont on les accusait.
Mais ce sont peut-être les images de Yurie Nagashima qui incarnent le mieux l’esprit rebelle de cette exposition. Une grande photo couleur domine : un autoportrait de 2001 qui montre l’artiste, cigarette au bec et veste en cuir noir, exhibant son ventre de femme enceinte et agitant son majeur vers le spectateur. Heureuse d’être ici ? Eh bien, c’est compliqué.
Pour découvrir une autre exposition, celle de Sophie Calle Ne pas donner ni jeteril faut pénétrer dans l’imposant Hôtel de Ville du XVIIe siècle et descendre dans les entrailles du bâtiment. Ces voûtes sombres et humides étaient à l’origine des caves romaines, mais Calle les réimagine comme une catacombe personnelle ou un mémorial, les parsemant d’objets personnels, éclairés dans l’obscurité – une unique chaussure rouge qu’elle a un jour volée dans un magasin, couverte de moisissure, la robe mauve qu’elle portait pour son cinquantième anniversaire, des peintures du dernier mot prononcé par sa mère, une valise étiquetée de manière alléchante « Journaux Intimes » (une surprise pour les observateurs chevronnés de cet artiste le plus confessionnel : elle semble fermée à clé).

L’idée, explique-t-elle en voix off, est que ces objets vont progressivement pourrir ; certains pourraient même disparaître. L’inspiration est venue des préparatifs d’une exposition au Musée Picasso à Paris l’année dernière, au cours de laquelle une réserve a été inondée et des œuvres ont été endommagées. Mais, comme toujours avec Calle, il est difficile de savoir où s’arrête le théâtre, ou même où commence.
Après cela — sans parler de l’assaut incessant d’images qui caractérise Arles pendant la saison des photos — vous seriez pardonné de vouloir donner du repos à vos rétines. Le rayon vertune modeste installation dans le cloître roman de l’ancienne cathédrale réalisée par l’artiste franco-marocain Mustapha Azeroual et la commissaire parisienne Marjolaine Lévy, offre un baume visuel apaisant.
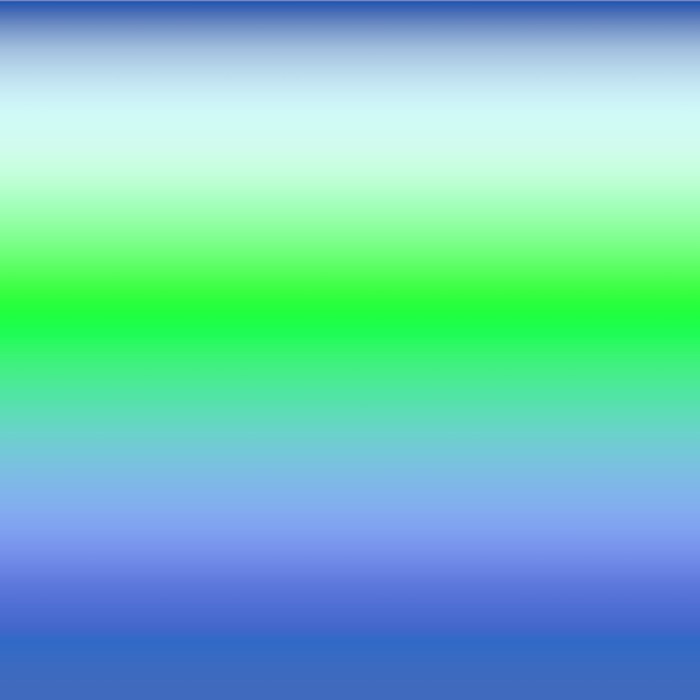
Nommée d’après un phénomène optique insaisissable, le bref éclair vert que l’on peut parfois apercevoir au lever ou au coucher du soleil, la pièce a été assemblée à partir d’environ 80 photographies du soleil prises par des personnes en mer dans des océans lointains, leur couleur extraite et remixée numériquement, pixel par pixel.
Dans l’espace en pierre, deux écrans imprimés se font face, scintillant de ce qui semble être toutes les teintes existantes. L’un, un lever de soleil abstrait, est dominé par des jaunes, des bleus et des roses froids. En face, la version d’Azeroual du coucher de soleil est plus chaude et plus intense, des kakis en colère aux écarlates et aux coraux jusqu’aux lavandes et aux gentianes.
Au fur et à mesure que vous vous déplacez entre elles, les couleurs se transforment et nagent sous vos yeux, sans jamais être complètement solides. C’est comme essayer d’entraîner vos yeux à observer une bulle de savon qui passe, et c’est tout aussi impossible. Vous pourriez penser à Turner ou à Rothko. Ou vous pourriez simplement vouloir fermer les yeux, cette fois pour les bonnes raisons.
Les Rencontres d’Arles se déroulent jusqu’au 29 septembre ; rencontres-arles.com
Soyez les premiers à découvrir nos dernières histoires — Suivez FTWeekend sur Instagram et Xet abonnez-vous à notre podcast La vie et l’art où que vous écoutiez

