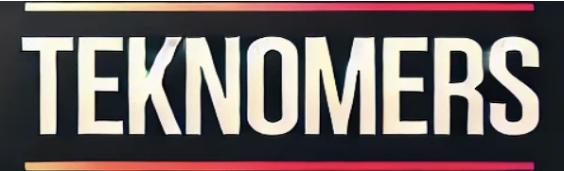L’Occident peut-il maintenir son système de libertés civiles et d’égalité des droits à une époque polarisée ? Nous sommes à un carrefour historique : y aura-t-il plus de débats ou plus de violence ? Telles sont les questions qui ont toujours préoccupé le philosophe politique Larry Siedentop. Et il était de moins en moins optimiste quant à un bon résultat. Il est décédé jeudi à Londres à l’âge de 88 ans.
Siedentop est né à Chicago en 1936 et avait des ancêtres germano-néerlandais. Il a étudié entre autres à Harvard et a obtenu son doctorat en 1966 grâce à une bourse Marshall avec Sir Isaiah Berlin à Oxford, avec une thèse sur les penseurs conservateurs après la Révolution française. Ce n’est qu’à l’âge de 64 ans que Siedentop, qui enseignait alors l’histoire politique à Oxford depuis vingt ans, fit sa percée avec La démocratie en Europe (2000). Dans ce livre ambitieux, il jaugeait la « santé politique » du continent, comme son modèle, le noble français Alexis de Tocqueville, l’avait fait à partir de 1835 dans son récit de voyage depuis les jeunes États-Unis, De la démocratie en Amériqueauquel le titre fait référence.
Tocqueville pensait que l’équilibre entre pouvoir central et autonomie locale y était mieux trouvé et pouvait servir d’exemple pour sa patrie post-napoléonienne. Selon Siedentop, trouver un tel équilibre reste le problème des pays européens. « Où sont les Madison européennes ? », demande-t-il en faisant référence à James Madison (1751-1836), « père » de la Constitution américaine.
Le fédéralisme américain n’est pas une panacée pour l’Europe, a-t-il déclaré. CNRCet il est également peu probable que « les Américains puissent recommencer aujourd’hui ». […] mais l’Europe ne peut commencer à déterminer où elle veut aller qu’en examinant sérieusement le modèle américain.»
L’Europe indifférente
Cela ne s’est pas produit. En Europe, trois modèles d’État se font concurrence – le centraliste français, l’Allemagne fédéraliste et le britannique plus informel – mais il n’y a pas de débat à ce sujet au niveau européen. Sans parler des régions et des cultures qui « transcendent les États-nations ». Au lieu de cela, l’Europe est devenue indifférente à ce qu’elle représente et regarde principalement sous un angle économique et matérialiste. Depuis la fin de la guerre froide et une prospérité sans précédent, « l’idée presque marxiste s’est installée selon laquelle tout se réglera tout seul ». Mais le consumérisme – « l’Europe comme supermarché » – pousse l’Union européenne vers une crise administrative et démocratique, prédit-il.
Les citoyens se sentent de moins en moins liés à ceux qui les gouvernent. Le Parlement européen a du pouvoir mais peu d’autorité. Les gouvernements nationaux ont toujours de l’autorité, mais de moins en moins de pouvoir. Et cela constitue un terrain fertile pour les populistes qui prétendent que tout le pouvoir devrait revenir aux États nationaux et qui veulent quitter l’Union, a-t-il déclaré, ce qui est une illusion en période de problèmes (et de bénédictions) transfrontaliers.
Crise morale
En outre, selon Siedentop, l’Europe traverse une deuxième crise morale : elle cherche de moins en moins à rechercher « pourquoi nous croyons ce que nous croyons ». Après les attentats terroristes perpétrés par des extrémistes musulmans à Londres (2005), les attentats sont devenus de plus en plus fréquents en France. Même si Siedentop dit éprouver « principalement de l’admiration » pour la France, il se montre extrêmement critique à l’égard de l’establishment qui ne fait pas assez pour empêcher les jeunes Français, immigrés de la deuxième ou de la troisième génération, de se sentir rejetés et donc de les abandonner. Il est alors « compréhensible que l’islam extrême comble un vide moral pour ces garçons », a-t-il déclaré en 2015. CNRC.
« Si nous ne comprenons plus que le libéralisme ne va pas de soi mais a un fondement moral, nous oublions la valeur de nos libertés acquises. Nous courons alors le risque de devoir mener le débat selon les termes des critiques, qui considèrent l’Occident comme vide et amoral.»
Siedentop a publié en 2014 sur la question de savoir quelles sont ces valeurs occidentales Inventer l’individu. Il existe en gros deux types de libéralisme : celui d’Adam Smith écossais du XVIIIe siècle, qui s’appuie principalement sur le libre marché. Et le libéralisme de Tocqueville, moralement chargé de responsabilité sociale et de justice. Smith et ses descendants, comme Thatcher et Reagan (et Mark Rutte avec son hymne au manque de vision), ont vidé le libéralisme de son âme.
Selon Siedentop, le libéralisme n’est pas né des Lumières, comme une protestation contre l’Église autoritaire, mais avec l’accent mis sur la liberté individuelle et la conscience personnelle, qui veut également garantir la liberté d’autrui, ses racines remontent au christianisme primitif. Le message de Paul selon lequel tous les hommes sont égaux devant Dieu s’est développé au Moyen Âge dans l’idée que tous étaient égaux devant la loi. Selon Siedentop, ce « tremblement de terre moral » a constitué la base d’une démocratie représentative fondée sur les droits fondamentaux de chaque « individu » au lieu de « liens anciens et involontaires », tels que le sexe, la tribu, la caste ou la classe.
Lire aussi
Une guerre civile autour de la laïcité et de la religion
Le libéralisme n’est donc pas antichrétien, mais plutôt un « christianisme laïc ». Le fait qu’il y ait une « guerre civile » entre religion et laïcité en Europe est donc « tragique et inutile », a-t-il déclaré. Revoir la France où le laïcité – l’absence de religion dans le domaine public – a été canonisée. Et selon lui, c’est aussi un malentendu que de parler de « racines judéo-chrétiennes », car à bien des égards leurs idées sont totalement incompatibles.
Ce fut son dernier livre, à moins que ne soit publié à titre posthume un autre livre sur Tocqueville, sur lequel Siedentop – entre-temps Sir Larry – travaillait encore alors que sa santé se détériorait. Il n’était pas marié, maisTocqueville est une bonne compagnie« , il a dit.
« Si nous, en Occident, ne comprenons pas la profondeur morale de notre propre tradition, comment pouvons-nous espérer… conversation de l’humanité pouvoir façonner ? », écrit-il à la fin de Inventer l’individu. Selon lui, le seul espoir réside dans une telle « conversation », également comme contrepoids à l’Islam et à la Chine, où l’individu doit se détourner de la religion ou de l’État. Son idéal, dit-il, était d’organiser un tel débat au niveau européen, de préférence en public et à la télévision : une sorte de « Conférence de Davos pour les questions fondamentales », par exemple au Palais de la Paix à La Haye. Il connaissait bien cette ville ; après sa retraite, il fut affilié au NIAS de Wassenaar.