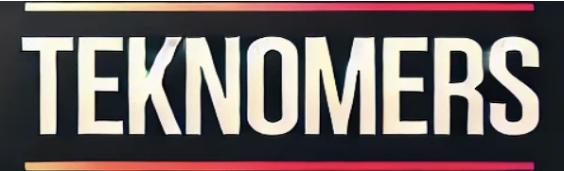Recevez des mises à jour gratuites sur la politique étrangère des États-Unis
Nous vous enverrons un Résumé quotidien myFT e-mail récapitulant les dernières politique étrangère américaine nouvelles tous les matins.
Quand les États-Unis parlent, le monde écoute. C’est, après tout, la puissance la plus influente du monde. Cela ne tient pas seulement à sa taille et à sa richesse, mais aussi à la puissance de ses alliances et à son rôle central dans la création des institutions et des principes de l’ordre actuel. Elle a joué un rôle décisif dans la création des institutions de Bretton Woods, de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de l’Organisation mondiale du commerce. Il a promu huit cycles successifs de négociations commerciales multilatérales. Il a gagné la guerre froide contre l’Union soviétique. Et dès le début des années 1980, elle a poussé à une ouverture profonde et large de l’économie mondiale, accueillant La Chine à l’OMC en 2001. Que cela nous plaise ou non, nous vivons tous dans le monde que les États-Unis ont créé.
Maintenant, souffrant des remords de l’acheteur, il a décidé de le refaire. Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, a exposé les aspects économiques de la nouvelle vision américaine dans un discours prononcé le 20 avril. Sept jours plus tard, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a prononcé un discours encore plus large, quoique complémentaire, sur « Renouveler le leadership économique américain ». Cela représentait une répudiation de la politique passée. Cela pourrait simplement être considéré comme un retour à l’interventionnisme d’Alexander Hamilton. Pourtant, cette fois, l’agenda n’est pas pour un pays naissant, mais pour la puissance dominante du monde.
Que disait Sullivan ? Et qu’est-ce que cela pourrait signifier pour les États-Unis et le monde ?
Le point de départ est domestique. Ainsi, une « économie mondiale en mutation a laissé derrière elle de nombreux travailleurs américains et leurs communautés. Une crise financière a secoué la classe moyenne. Une pandémie a révélé la fragilité de nos chaînes d’approvisionnement. Le changement climatique menaçait des vies et des moyens de subsistance. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a souligné le risque d’une dépendance excessive. Plus étroitement, l’administration se voit confrontée à quatre grands défis : l’épuisement de la base industrielle ; la montée en puissance d’un concurrent géopolitique et sécuritaire ; la crise climatique qui s’accélère ; et l’impact de la montée des inégalités sur la démocratie elle-même.

En une phrase clé, la réponse est d’être « une politique étrangère pour la classe moyenne ». Qu’est-ce que cela signifie alors ?
D’abord, une « stratégie industrielle américaine moderne », qui soutient des secteurs jugés « fondamentaux pour la croissance économique » et aussi « stratégiques du point de vue de la sécurité nationale ». Deuxièmement, la coopération « avec nos partenaires pour s’assurer qu’ils renforcent également les capacités, la résilience et l’inclusion ». Troisièmement, « aller au-delà des accords commerciaux traditionnels vers de nouveaux partenariats économiques internationaux innovants axés sur les principaux défis de notre époque ». Cela comprend la création de chaînes d’approvisionnement diversifiées et résilientes, la mobilisation d’investissements publics et privés pour « la transition vers une énergie propre », la garantie « de la confiance, de la sécurité et de l’ouverture dans notre infrastructure numérique », l’arrêt d’un nivellement par le bas de la fiscalité des entreprises, le renforcement de la protection des travailleurs et l’environnement et la lutte contre la corruption.

Quatrièmement, « mobiliser des billions d’investissements dans les économies émergentes ». Cinquièmement, un plan pour protéger « les technologies fondamentales avec une petite cour et une haute clôture ». Ainsi : « Nous avons mis en place des restrictions soigneusement adaptées sur les exportations de technologies de semi-conducteurs les plus avancées vers la Chine. Ces restrictions sont fondées sur des préoccupations simples de sécurité nationale. Les principaux alliés et partenaires ont emboîté le pas. Il comprend également « l’amélioration du filtrage des investissements étrangers dans des domaines critiques liés à la sécurité nationale ». Celles-ci, insiste Sullivan, sont des « mesures sur mesure », pas un « blocage technologique ».
Il s’agit en effet d’un changement fondamental dans les objectifs et les moyens de la politique économique américaine. Mais la profondeur et la durabilité de ces changements dépendent de la mesure dans laquelle ils reflètent un nouveau consensus américain. Là où il est nationaliste et protectionniste, il le fait déjà sûrement. Là où elle minimise les priorités des entreprises et le rôle des marchés, elle pourrait aussi s’avérer durable. Les républicains populistes de Donald Trump pourraient sûrement accepter presque tout cela.

Les nouveaux objectifs ont-ils un sens ? À certains égards fondamentaux, oui. Je viens de publier un livre intitulé La crise du capitalisme démocratique, je suis d’accord que la colère et la déception de ce que les Américains appellent « la classe moyenne » est une réalité dangereuse. Je conviens également que le climat est une priorité importante, que les chaînes d’approvisionnement doivent être résilientes et que la sécurité nationale est une préoccupation légitime de la politique commerciale. La Russie nous l’a sûrement appris.

Pourtant, cela fonctionnera-t-il réellement pour rendre les Américains et le reste d’entre nous meilleurs et plus sûrs ? Un doute concerne l’échelle. Sullivan déclare, par exemple, qu’il est « estimé que le total des capitaux publics et des investissements privés du programme du président Biden s’élèvera à environ 3,5 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie ». Cela représente au plus 1,4 % du produit intérieur brut sur cette période, ce qui est bien trop peu pour être transformateur. Une autre est qu’il est difficile de faire fonctionner la politique industrielle, en particulier pour les économies à la frontière technologique. Une autre concerne le caractère perturbateur de cette nouvelle approche pour les relations économiques et politiques avec le reste du monde, notamment (mais pas seulement) avec la Chine, notamment sur le commerce.

En particulier, il sera difficile de distinguer les technologies purement commerciales de celles ayant des implications en matière de sécurité. Il sera également difficile de distinguer les amis américains des ennemis, comme le montrent les réactions mondiales à l’invasion russe de l’Ukraine. Enfin et surtout, il va être difficile de persuader la Chine que ce n’est pas le début d’une guerre économique contre elle. Pourtant, la Chine détient déjà de nombreuses cartes dans un tel combat, comme l’a noté Graham Allison de Harvard pour le cas des panneaux solaires. Les terres rares sont un autre cas de ce genre.
Surtout, la nouvelle approche ne fonctionnera que si elle conduit à un monde plus prospère, pacifique et stable. Si cela conduit à un monde fracturé, à un échec environnemental ou à un conflit pur et simple, il échouera dans ses propres termes. Ses auteurs doivent être prudents dans le calibrage de l’exécution de leur nouvelle stratégie. Cela pourrait mal se retourner.
Suivez Martin Wolf avec monFT et sur Twitter