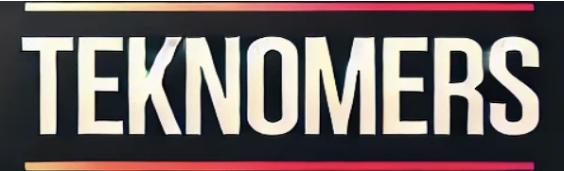«C’est sans aucun doute l’un des nouveaux développements les plus prometteurs que j’ai rencontrés», déclare le radiothérapeute-oncologue Piet Dirix à propos de la radiothérapie qu’ils étudient à l’hôpital universitaire d’Anvers. Ils le font avec des animaux de laboratoire depuis un an et demi, mais cette année, ils espèrent également irradier les premiers patients humains atteints de tumeurs agressives avec une thérapie flash.
La radiothérapie des cellules tumorales est une thérapie anticancéreuse couramment utilisée. Mais ils ne sont pas impeccables. Environ une tumeur cancéreuse sur trois s’avère résistante, et il est également possible que les organes environnants soient endommagés par les radiations. Dans certains cas, cela signifie que les médecins doivent administrer une dose plus faible que ce qui serait réellement idéal pour lutter contre la tumeur. « Si vous irradiez le cerveau, il y a toujours un risque que vous affectiez également les tissus cérébraux sains », explique Dirix. « Tout comme les radiations dans l’abdomen peuvent endommager la vessie, le rectum ou d’autres intestins. Heureusement, seule une minorité de patients ont des problèmes à long terme, mais c’est bien sûr quelque chose qui vous tient éveillé en tant que médecin.
Avec la thérapie flash, vous administrez une forte dose de rayonnement en une fraction de seconde. Des études préliminaires montrent que l’impact sur la tumeur est au moins aussi important. C’est aussi moins cher, car une à deux séances suffisent. Le temps de traitement passe alors de sept semaines à à peine deux semaines. Et surtout, il semble y avoir moins de dommages aux organes environnants avec la thérapie flash. À Anvers, par exemple, ils ont découvert que la mémoire des souris dont le cerveau avait été irradié avec une thérapie flash tenait beaucoup mieux que les souris qui avaient reçu un rayonnement conventionnel. Ils ont testé cela en laissant des souris trouver leur chemin dans un labyrinthe.
« Il existe plusieurs hypothèses pour lesquelles la thérapie flash cause moins de dommages collatéraux », explique Dirix. « Par exemple, il est possible qu’une dose aussi rapide et élevée élimine tout l’oxygène à proximité du rayonnement. En conséquence, les tissus sains peuvent devenir résistants, tandis que les tumeurs sont attaquées. Mais il se peut aussi que les tissus sains résistent mieux car il y a moins de réactions inflammatoires du système immunitaire. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour fournir des informations plus concluantes à ce sujet.
Tumeurs plus profondes
Pour l’instant, la recherche porte principalement sur les types de cancer situés près de la surface de la peau. En Suisse, la thérapie flash a déjà été utilisée chez des patients atteints d’un cancer de la peau, tandis qu’à l’Université américaine de Cincinnati, elle s’est déjà avérée efficace chez des patients atteints d’un cancer métastatique des bras et des jambes. Mais à l’avenir, il pourrait également être appliqué à des tumeurs cachées jusqu’à vingt centimètres de profondeur dans le corps.
À cette fin, le CHUV de Lausanne, en Suisse, a conclu un partenariat avec le Centre européen de recherche nucléaire (CERN) et la société française Theryq. Ensemble, ils construisent un appareil qui pourra également s’attaquer aux tumeurs les plus difficiles à traiter dans deux ans. Les premiers essais cliniques sont prévus pour 2025.
« Reste à savoir ce que donneront ces recherches », déclare Dirk Van Gestel, expert en radiothérapie et directeur médical de l’Institut Bordet de Bruxelles. « Aujourd’hui, le point faible de la technologie est qu’il y a trop de décroissance de dose si l’on veut irradier des tumeurs plus profondes. Avec l’appareil en Suisse, vous pourriez éventuellement aussi irradier le cerveau sans avoir à opérer au préalable. Mais avant d’en arriver là, nous avons encore besoin de beaucoup de recherches.