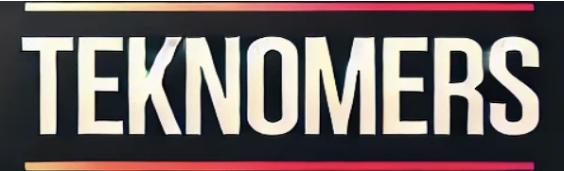LELe point de départ est une donnée. Les femmes sont plus solidaires. Le rapport le dit Nous faisons un don, créé par l’Institut italien du don (52% des donateurs sont des femmes). Et les données sur ceux qui travaillent dans le tiers secteur (plus de 75% des personnes impliquées dans les associations de solidarité sont des femmes) et effectuent des achats solidaires. Ceci est confirmé par une enquête promue par Comité du Testament Solidaire parmi les 28 organisations membres : 69,2 % de ceux qui font un legs sont des femmes. Mais si les données sont irréfutables, les raisons de ce record ne sont pas évidentes. Nous en avons parlé avec Maura Gangitano, philosophe et fondatrice du projet Tlon.

La solidarité est-elle une femme ? Une explication philosophique
Les femmes semblent plus enclines à donner : de l’énergie, du temps et même de l’argent. Des parties de soi, pour améliorer le bien-être collectif. Et cela « naturellement pas pour des raisons biologiques mais culturelles: nous sommes historiquement habitués à affronter une série de difficultés, nous les avons vécues et nous connaissons la valeur de la coopération pour résoudre des moments compliqués », explique Gancitano.
Le « principe de responsabilité »
Et ce n’est pas tout : « Les femmes sont les plus grandes consommatrices de produits culturels, à commencer par les livres. Et cela augmente le leur le respect de ce que Hans Jonas a défini comme le principe de responsabilité. Ils te choisissentn agir de manière responsablece qui nous permet de retrouver le sens de la limite », et de livrer à qui viendra après un monde meilleur ou du moins vivable.
Aussi la propension à un comportement durable et la soi-disant éco-anxiété sont plus féminines que masculines. Bref, il y a un « écart écologique entre les sexes ». «En raison de notre responsabilité sociale, il nous est difficile d’être sceptiques ou indifférents aux données concernant l’avenir du monde», poursuit Gancitano. «Alors qu’il peutMalheureusement, les plus sceptiques sont les hommespas des jeunes mais des adultes, ce qui pourrait le plus changer les chosescar ils occupent des postes clés dans le système.
La solidarité comme habitude de soin et d’émotions
De plus, la dimension du soin à laquelle nous avons été relégués pendant une si grande partie de l’histoire nous a conduit à «gérer les émotions et les sentiments, la souffrance et la peur, et ne pas les ressentir comme humiliants. Au contraire, il a toujours été demandé à l’homme de démontrer qu’il sait accumuler, contrôler et capitaliser », poursuit Gangitano. Et il a encore du mal à admettre qu’il est fragile et vulnérable.
Alternatives à « l’héritage de père en fils »
Si la philanthropie frappe, elle peut être liée au sentiment d’identité : elle peut devenir un attribut de l’image publique, voire d’un homme. « Sinon, le patriarche distribue l’argent à sa progéniture, sans aucun doute». Le lien du sang s’applique, l’héritage se transmet d’une génération à l’autre.
La condition d’interdépendance (Judith Butler)
Alors que « ça appartient au féminin conscience de ce que la philosophe américaine Judith Butler (Quel monde c’estTemps nouveaux) appelle la condition d’interdépendance», poursuit Gancitano. C’est-à-dire le fait que notre existence est liée à celle des autres et à l’environnement qui nous entoure. L’individu n’est pas renfermé sur lui-même, voué à son intérêt personnel. Nous nous ouvrons à l’idée de pouvoir contribuer au bien-être collectif, même de ceux qui viendront après nous, et que nous ne connaîtrons jamais.
Donc, non seulement en faisant preuve de solidarité aujourd’hui, mais aussi en laissant une somme, même minime, à celui qui viendra demain, et qui n’est ni notre fils ni notre petit-fils. Comme en témoignent les données sur les legs de solidarité, à caractère féminin. «Ce sont de très petits gestes sans nom ni prénom que beaucoup de femmes font, sans attendre d’applaudissements ou de reconnaissance», poursuit Gancitano.
Le fait que la solidarité soit féminine apparaît également clairement lorsqu’on examine l’histoire de la pensée occidentale. «La réflexion sur le soin et l’entretien des petites choses du monde, comme l’appelle James Hillman, est entrée dans la réflexion philosophique. seulement depuis que les femmes parlent et écrivent. Auparavant, il s’agissait de questions considérées comme non pertinentes et de peu d’importance.par rapport aux thèmes élevés et classiques ».
Femmes et solidarité, suggestions de lectures
De manière constante, Gancitano suggère enfin quelques bonnes lectures à partir duquel commencer à approfondir ces thèmes
Le Affiche de soinsÉdition Allègrepar le collectif anglais Collectif de soins. Ce qui nous invite à profiter des bonnes pratiques des mouvements féministes et écologistes pour tenter de penser un véritable « état de soin » : une nouvelle idée de démocratie orientée vers les besoins collectifs.
Les soins deviennent collectifs, au-delà de la famille traditionnelle

Après le travailpar Helen Hester, professeur de genre, technologie et politique culturelle à l’Université de West London, écrit avec son partenaire Nick Srnicek, Edizioni Tlon. Dans lequel l’auteur suggère quelques des possibilités concrètes, des principes, pour minimiser le travail nécessaire à l’expansion de la liberté. Tout d’abord les « soins collectifs », compris comme émancipation et expansion des relations de soins au-delà de la famille qui est « un bastion du pouvoir patriarcal ». C’est aussi un puissant mécanisme intergénérationnel de concentration des richesses et de perpétuation des inégalités qui y sont liées » (comme indiqué plus haut, avec le passage de l’héritage d’une génération à l’autre).
Silvia Federici et Rosi Braidotti, deux penseuses à redécouvrir
Chez les penseurs historiques, il faut les redécouvrir Silvia Federici (Parme, 20 avril 1942), sociologue, philosophe et militant qui, dans les années 70, fut l’un des protagonistes du mouvement international pour Salaires pour le travail domestique (ici, elle est interviewée sur l’avenir du travail par le New York Times).
Ainsi que Rosi Braidottifondatrice de la Netherland Research School of Women’s Studies, pour la théorie du sujet nomade, et féministe, qui change et rejette toute définition univoque et simpliste, en premier lieu celle du non-masculin. Depuis les années 80, il s’est opposé au fixité des identités granitiquesqui fonctionne «pour un système de pouvoir qui privilégie les hommes, les blancs, les hétérosexuels, les citoyens légaux, les riches, les capables», convaincu que la pensée critique combinée à un engagement actif peut changer le monde (ici ses livres, publiés par Valsecchi).
iO Donna © TOUS DROITS RÉSERVÉS