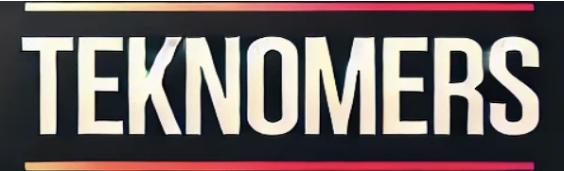Dans l’épisode 30 de sa chronique, Julia Friese explique ce que signifient les termes « influenceur beige » et « algo-speak ».
Trois constats :
1. tons de terre neutres
Le mot « été » peut désormais être lu avec audace. Nous aimons le soleil. Toujours. Tant que l’on ne pense pas aux incendies qu’il déclenche et au fait qu’ils démarrent plus tôt chaque année, tout deviendra de plus en plus chaud jusqu’au jour où ce sera « l’été éternel » (Franziska Gänsler. 2022). Mais sans ce contexte, « l’été » peut encore être compris de manière positive. Le terme ressemble actuellement à « Pourquoi suis-je vivant » d’ANOHNI et les Johnsons. Une chanson si émouvante que si vous n’écoutez pas attentivement, vous ne réalisez pas que vous dansez sur des lignes comme « Watching nature swoon and soupir / Watching all the water dry ».
Sarah Manavis écrit dans le « Guardian » que les jeunes de moins de 30 ans ont été victimes de ce qu’on appelle les influenceurs beiges, dans l’impression d’une ambiance apocalyptique éclatante. Molly-Mae Hague et Matilda Djerf inciteraient leurs millions de followers à romancer un quotidien simple. Décomposer cela en routines consistant à allumer des bougies et à faire de l’exercice à la maison. Ils donnent l’exemple en s’installant dans des tons neutres et des relations monogames de longue durée dans lesquelles on préfère souvent rester à la maison pour sortir. Manavis critique ces jeunes. Tu es trop ennuyeux pour elle. Trop conventionnel.
2. Algo-langage neutre en termes de sexe
L’omission de la débauche se retrouve également dans le langage. Le sexe n’est plus du sexe sur les réseaux sociaux. Vous faites l’amour là-bas. Et il est le$bian. Un TikTok sur les violences sexuelles dit parfois ceci : « Il fut un temps où j’étais obligée de porter du mascara et cela me rendait vraiment triste. Après cela, j’ai essayé de nombreux mascaras différents mais je détestais chacun d’eux. Ensuite, j’ai arrêté de porter du mascara – et honnêtement, je suis plus heureuse maintenant. (Il ne s’agit pas de mascara) »
C’est une langue qui rappelle le fait de parler en présence d’enfants. Quand ils ont fait irruption dans le monde de « S*x And Te City », on l’appelait « Mr. Grosse peinture, peinture sur le bord » – c’est-à-dire avec son mascara. Or, « l’algo », c’est l’enfant en présence duquel vous parlez. Les excès, c’est-à-dire tout ce qui pourrait être filtré par l’algorithme comme étant trop chaud ou trop indécent, sont convertis en langage fantastique – oui, presque réécrit dans des tons terreux neutres.
3. écrivain auto-neutralisant
« Mauvais mots » était le thème du festival prosanova pour la jeunesse littéraire de Hildesheim cette année. Au prix Bachmann à Klagenfurt, le texte de Valeria Gordeev sur le nettoyage minutieux d’un appartement comme moyen de surmonter tout ce qui est guerrier et tout ce qui est mauvais a gagné. Le discours d’ouverture de l’écrivaine Tanja Maljartschuk, née en Ukraine et émigrée à Vienne, a été impressionnante : elle se considère « comme une auteure brisée, une ancienne auteure, une auteure qui a perdu sa langue ».
Elle avait peur du langage, qui pourrait convaincre des millions de citoyens d’en assassiner d’autres. Il lui semble désormais absurde de faire de belles et louables textes à partir d’une souffrance réelle. N’est-il pas plus important de se demander « comment éviter que l’horreur ne se produise plutôt que de se demander si on peut encore écrire de la poésie après » ? L’un des points de critique les plus récurrents de la part du jury était que les textes de l’année étaient trop conventionnels, c’est-à-dire trop algo-parlants, trop beiges, trop Matilda Djerf.
Peut-être que le jury est en moyenne trop âgé, a vécu trop d’années conventionnelles pour comprendre l’aspiration au conventionnel – le « midcult » (Moritz Baßler, 2022). D’une manière générale, il s’agit du désir d’une vie dans laquelle « été » n’est pas un gros mot.
Cette chronique est parue pour la première fois dans le numéro Musikexpress 09/2023.